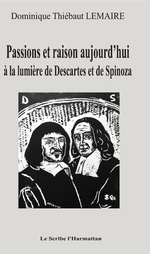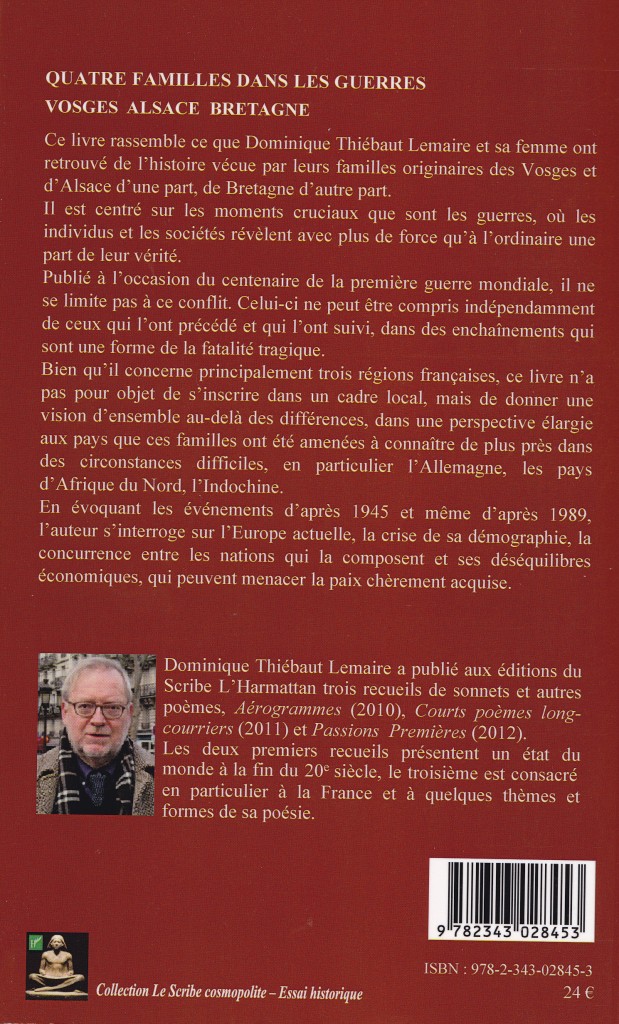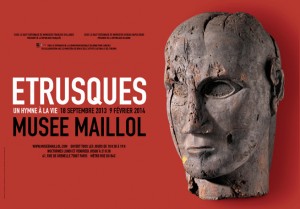Le cadre géographique dans lequel a vécu la famille Rivier dont il est question dans cet article est la région de l’Aven située entre Quimper et Quimperlé dans le sud du Finistère, où se trouvent notamment les communes de Melgven, Rosporden, Scaër, Tourc’h…
Cette famille descend d’Yves Postic (Scaër 19 juin 1754-Brest 22 mai 1794). « Ménager » (sorte de laboureur) dans la paroisse de Scaër, syndic (de la corvée) des grands chemins en 1789, Yves Postic ajoutait à son activité de cultivateur celle de priseur qui se déplaçait pour estimer et vendre les biens saisis, et qui intervenait aussi lors des successions. Il a signé le cahier de doléances de la sénéchaussée de Concarneau le 7 avril 1789. Administrateur du département du Finistère à partir de 1792, fonction correspondant à celle de conseiller général aujourd’hui, il a été guillotiné à Brest en 1794 comme la plupart de ses collègues de l’administration départementale, accusés d’avoir attenté à « l’indivisibilité de la République ».
Yves Postic et Marie Audren ont eu trois filles. La plus jeune, Marie Josèphe Postic (Scaër/Keriquel 24 juin 1790-Tourc’h 2 mai 1850), a épousé à Tourc’h le 27 août 1809 Louis Le Rivier (Tourc’h/Kerannou 18 août 1790-Tourc’h/bourg 10 avril 1845), cultivateur (voir l’annexe I pour une présentation d’ensemble de leur descendance).
P.R. RIVIER ET SES DESCENDANTS ENTREPRENEURS EN BATIMENT
A partir de 1850, le secteur du bâtiment a connu dans la région une grande activité, dont les maçons Rivier devenus entrepreneurs ont profité. Les constructions publiques (écoles, mairies…) se sont multipliées. Et de nombreux propriétaires de ferme se sont fait construire une nouvelle habitation, de même que les notables.
Pierre René Rivier
Fils de Louis Rivier et de Marie Josèphe Postic, petit-fils d’Yves Postic, administrateur du Finistère guillotiné à Brest en 1794, Pierre René Rivier (Scaër 3 avril 1825-Melgven 10 décembre 1874), maçon domicilié à Rosporden/Saint-Hilaire en 1850, à Melgven/Cadol en 1861, s’est marié à Melgven le 29 juin 1853 avec Perrine Le Guiriec (née à Melgven le 14 avril 1825), fille de Philibert, tisserand, et de Marie Perrine Buaré, meunière. La famille Le Guiriec était une famille de tisserands, mais Pierre Le Guiriec (né à Melgven en 1830), frère de Marie Perrine, était maçon. Le clocher de l’église de Tourc’h porte plusieurs dates et inscriptions (d’après www.infobretagne.com/tourch), en particulier sur la seconde balustrade : « Rivier R.P. Flao G. » Le premier de ces noms est peut-être celui de René Pierre Rivier.
Pierre René Rivier et Perrine Le Guiriec sont les parents de : – Pierre, qui s’est marié avec Jeanne Carduner, et dont sont issus les Rivier entrepreneurs en bâtiment (voir ci-dessous); – Louis, qui s’est marié avec Louise Guillou (voir l’annexe II); Louis Rivière a été entrepreneur et hôtelier à Rosporden (hôtel de la gare) ; président de l’Association sportive rospordinoise, il a donné son nom au stade de Rosporden.
Pierre Rivier et sa femme Jeanne Carduner
Fils de Pierre René Rivier et de Marie Perrine Le Guiriec, Pierre (Pierre Louis Marie) Rivier ou Rivière (Melgven/Pontinao 28 mai 1859-Melgven/Kerscouarnec 6 septembre 1892) s’est marié à Kernével le 24 novembre 1880 avec Jeanne Marie Carduner (née à Kernével le 8 septembre 1858, décédée en 1911), d’après les différents actes d’état civil cultivatrice (1880, 1883, 1885), puis ménagère (1887, 1890, 1892), fille d’Alain Carduner et d’Isabelle Le Dez, cultivateurs. Cultivateur à son mariage, Pierre Rivier est ensuite maçon (1883, 1885), maître-maçon (1887, 1890), entrepreneur (1892) à Melgven (Cadol) au lieu dit Kerscouarnec. Il est à noter qu’il a été témoin à la naissance à Rosporden le 30 juin 1890 d’Augustine Marie Clignac, fille du percepteur des contributions à Rosporden.
Pierre Rivier ou Rivière et Jeanne Carduner sont les parents de Perrine; Isabelle Marie ; Pierre; Yves ; François (les quatre premiers dénommés Rivière au lieu de Rivier):
– Perrine (Marie Perrine Rose) Rivière (Melgven/Kerscouarnec 30 août 1881-Kernével 24 octobre 1958) a épousé à Melgven le 16 février 1909 Joseph Jean Marie Bourbigot (né à Melgven le 11 avril 1881), mort pour la France à Saint-Nicolas (62) le 16 juin 1915; fille de Perrine, Jeanne (dite Jeannette) a épousé Jérôme Le Beux et a eu deux enfants : Pierre et Yvi ; ce dernier, né à Rosporden, interne des hôpitaux de Paris, puis chercheur, a travaillé pendant de nombreuses années à Québec où il était professeur de médecine à l’université Laval ; au début de mars 2015, âgé de 82 ans, il habitait en Colombie-Britannique dans l’ouest canadien ;
– Isabelle Marie Rivière (Melgven/Kerscouarnec 17 février 1883-Melgven/Kerscouarnec 14 septembre 1892) est morte de la typhoïde quelques jours après son père ; – Pierre (Pierre Marie Guillaume) Rivière (Melgven/Kerscouarnec 17 février 1885-Nantes 1er mars 1947) s’est marié à Landudal le 12 janvier 1910 avec Catherine (Marie Catherine) Le Floch (1884-1963), fille de François Le Floch et de Marie Jeanne (Le) Page, cabaretiers dans les années 1880, aubergiste et ménagère dans les années 1890, d’après les actes de naissance de leurs enfants ;
– Louis (Louis Pierre Marie) Rivière (Melgven/Kerscouarnec 6 décembre 1887-Quimper 7 mars 1956), instituteur public, s’est marié à Beuzec-Conq le 12 avril 1913 avec Anne Virginie Le Bourhis, institutrice publique ;
– Yves (Yves René) Rivière (Melgven /Kerscouarnec 10 avril 1890-Etinchem 1er août 1916) s’est marié à Melgven le 18 janvier 1914 avec Anna Joséphine Le Goarant ; il est mort pour la France dans la Somme en 1916;
– François (Michel François) Rivier, dernier enfant, est présenté ci-dessous.
La sépulture, en granit de Kersanton des époux Rivier-Carduner, non loin des tombes de la famille de Kerguélen de Kerbiquet, est toujours visible dans la partie haute du cimetière de Melgven, à droite quand on regarde ce cimetière depuis l’entrée.
L’entreprise de bâtiment a construit notamment dans les communes de Beuzec-Conq (aujourd’hui Concarneau), Melgven, Rosporden, Tourc’h.
Dans Les sillons de Beuzec (voir la bibliographie), Louis-Pierre Le Maître note (page 49) que la plupart des fermes de Beuzec-Conq ont été reconstruites entre 1870 et 1914. Il a recueilli (pages 134-135) un témoignage sur les maçons et tailleurs de l’entreprise Rivière de Melgven qui a bâti la maison de l’exploitation de Kerhuel à Beuzec-Conq. Les propriétaires, Yves Le Noac’h et Marie Louise Le Cain, parents du vétérinaire Yves Le Noac’h, voulaient une nouvelle habitation, pour remplacer leur chaumière à deux pièces et trois fenêtres. En 1888, l’entreprise Rivière commence les travaux. La pose de la première pierre donne lieu à une petite fête. Dès le matin, l’eau de vie est largement distribuée, si bien qu’à midi, les maçons et les tailleurs sont ivres. A cette époque, les ouvriers buvaient tellement que les constructions n’avançaient pas. Yves Le Noac’h leur a donc supprimé la boisson et le travail est devenu plus régulier. Mais chaque fois qu’il passait sur le chantier, il se trouvait toujours un maçon pour grommeler le même refrain en breton: « s’il y a pas, y aura! S’il y a, y aura pas ! » N’y comprenant rien, le patron passait son chemin. Il a bien regretté par la suite de n’avoir su comprendre à temps l’avertissement : les ouvriers assoiffés se sont arrangés pour que la cheminée rejette toute la fumée dans la grande salle. « S’il n’y a pas à boire, il y aura de la fumée ! » A ce prix-là, disait le patron, il aurait mieux valu que je leur donne un litre d’eau-de-vie par jour !
Pierre Rivier étant mort de la typhoïde en 1892, sa veuve Jeanne Carduner, appelée « Cham Pe(r) Rir » (Jeanne de Pierre Rivier), a pris la relève à la direction de l’entreprise. D’après les sources familiales, elle tricotait en se rendant sur ses chantiers, notamment en allant surveiller la construction d’un mur de l’église de Tourc’h. A Rosporden, l’entreprise a édifié entre autres (était-ce du temps de Pierre Rivier ou du temps de sa veuve ?) une grande maison qui existe encore aujourd’hui (en 2012) à l’endroit où l’Aven sort de l’étang de Rosporden, et dont les encadrements de fenêtres sont surmontés d’un ornement de pierre en pointe de diamant. A Melgven, elle a construit par exemple la maison d’habitation de l’exploitation agricole de Cadol/Keralain. Elle aurait aussi édifié la mairie de Scaër, et peut-être celle de Châteauneuf. Elle aurait construit ou réparé une partie de la route de Quimper à Briec, dans la région d’Edern. Ce serait à cette occasion que le fils aîné, Pierre, aurait rencontré sa future femme, Catherine Le Floch, fille d’hôteliers de Landudal.
Les fils des époux Rivier-Carduner: Pierre Rivière et François Rivier
Après le décès de sa mère Jeanne Carduner en 1911, Pierre Rivière a repris l’entreprise, dont les installations à Cadol/Kerscouarnec ont été détruites (juste avant ou juste après la guerre de 1914-1918) dans un incendie et dans l’explosion des explosifs entreposés pour les travaux publics. Dans cette catastrophe, une domestique a trouvé la mort. L’entreprise a dû végéter pendant la guerre. La famille qui avait placé son argent dans les emprunts russes, a perdu une grande partie de son épargne. Diminué physiquement par la guerre (il a subi les gaz de combat allemands), prisonnier de guerre, Pierre Rivière a peut-être repris son activité de construction pendant un certain temps. Puis il s’est reconverti dans le négoce de bois-charbon et produits du sol créé par sa femme en 1914-1918. Mise en difficulté par la crise économique des années 1930, cette famille est alors partie s’installer vers 1935 à Nantes où Catherine Le Floch tenait une crêperie, rue Santeuil. Du mariage Rivière-Le Floch sont nés Anna qui a épousé Gabriel Le Bihan; Simone ; Louise dite Lisette (née en 1914), qui a épousé Charles Le Bec et qui a repris la crêperie de sa mère; Yvonne (1919-1969); Hélène (1921-2012), ancienne religieuse (sœur de Cluny), professeur de français, qui a épousé en 1980 Roger Pouchard (1913-1995); Guy (1924-1985), avocat, qui s’est marié avec Marie Le Rest (1921-2003).
Dernier enfant des époux Rivier/Rivière et Carduner, François (Michel François) Rivier (Melgven/Kerscouarnec 24 mars 1892-Melgven/Boulouard 20 mai 1955), titulaire du brevet supérieur, menuisier, compagnon du tour de France, a été mobilisé au 50ème régiment d’artillerie pendant la guerre de 1914-1918 (voir plus loin la partie consacrée aux guerres). Il s’est marié à Melgven le 26 février 1917 avec Adrienne (Adrienne Victoire Marie) Cotten (Melgven 12 août 1893-Quimperlé 20 septembre 1978), fille des défunts André Cotten et Euphrasie Dagorn, propriétaires cultivateurs à Melgven/Parcambroc. Un contrat de mariage a été signé la veille chez Me Alain Noël Biger, notaire à Bannalec, suppléant Me Jean Fichoux, notaire à Melgven. Les témoins des mariés ont été: Pierre Rivière, âgé de 62 ans, cultivateur, domicilié à Rosporden, cousin germain du père du marié; Joseph Daoudal, âgé de 24 ans, cultivateur, domicilié à Kernével, non-parent ; François Goarant, âgé de 40 ans, cultivateur, domicilié à Melgven, beau-frère de la mariée ; Yves Cotten, âgé de 28 ans, cultivateur, frère de la mariée. Canonnier, infirmier, François Rivier a été gravement blessé en 1918 (voir plus loin). D’après le document militaire de réforme, son signalement était le suivant : cheveux châtain ; yeux marrons ; front moyen ; nez rectiligne ; taille 1,63 m ; profession menuisier. Après la guerre de 1914-1918, il a créé sa propre entreprise dans le quartier de la Butte, dans la partie nord de la commune de Melgven, qui faisait partie de fait de l’agglomération de Rosporden. Sa menuiserie-parqueterie, qui a commencé avec trois employés en 1919, s’est développée en devenant une entreprise générale de bâtiment, l’entreprise Rivière (peut-être en reprenant l’entreprise familiale préexistante), jusqu’à atteindre après la guerre de 1939-1945 une cinquantaine de salariés, plus une vingtaine d’ouvriers indépendants employés par l’entreprise.
Les enfants de François Rivier et d’Adrienne Cotten
François Rivier et Adrienne Cotten ont eu quatre enfants: Albert, Jeanne, Andrée, Marie Yvonne.
Albert (Albert Joseph François) Rivier (Melgven 11 septembre 1919-Concarneau 1er juin 1997), ingénieur des arts et métiers d’Angers, président de la délégation spéciale de Rosporden en 1944-1945 (autorité dirigeante de la commune à la Libération), s’est marié à Rosporden le 26 décembre 1945 avec Anne Marie (Anne Marie Joséphine) Meur (née à Rosporden le 31 août 1923), fille de Jean Joseph Le Meur et de Jeanne Quéméré (Tourc’h/Bron 3 mai 1887-Rosporden 11 juillet 1969), aubergistes à Rosporden (« La vieille auberge »), qui se sont mariés à Rosporden le 30 juin 1910. Frère de Jeanne Quéméré, Joseph Quéméré (né à Tourc’h/Bron en 1895), soldat de 2ème classe, est mort pour la France à Ontheuil dans l’Oise en 1918.
Jeanne Rivier (Melgven 4 avril 1921-Draguignan 22 août 2002), étudiante en lettres classiques à l’université de Rennes, a épousé à Melgven le 9 août 1943 André (André Roger Marie) Scavennec (Rosporden 20 septembre 1920-Draguignan 5 avril 2004), élève de l’Ecole polytechnique (promotion 1941), diplômé d’études supérieures d’économie politique et de sciences économiques en 1951, par la suite ingénieur général des télécommunications, directeur régional des télécommunications (Provence Côte d’Azur), commandeur de la légion d’honneur. De ce mariage Scavennec-Rivier est née Maryvonne Scavennec qui a épousé Dominique Thiébaut Lemaire.
Andrée Rivier (Melgven 28 juin 1927-Quimper 22 juin 2005), professeur d’anglais dans l’enseignement secondaire, a épousé à Rosporden le 10 juillet 1954 Jean (Jean-Yves Christophe) Kerhervé (né à Bannalec le 11 mai 1927), dont l’ascendance est la suivante. Fils aîné d’Antoine et de Marguerite Garnier, Jean Antoine Kerhervé (Guiscriff 26 septembre 1849-Guiscriff 26 juillet 1908) s’est marié à Guiscriff le 8 février 1874 avec Marie Louise Kerveadou (1853-1896), couturière, fille d’un maçon (source: geneanet, bobred). De ce mariage sont nés notamment:
– Joseph Kerhervé (Guiscriff 5 décembre 1878-Perthes dans la Marne 25 février 1915), mort pour la France;
– Gabriel Etienne Louis Marie Kerhervé (Guiscriff/Poulfoss 2 octobre 1890-Bannalec 8 mai 1953). Ce dernier s’est marié à Bannalec le 31 janvier 1907 avec Marie Catherine Josèphe Neveu (Bannalec 15 avril 1891-Bannalec 27 septembre 1958). Il a été ouvrier à l’arsenal de Lorient, et bûcheron. De son mariage sont nés sept enfants, dont Jean (Jean Yves Christophe) Kerhervé, 5ème enfant et troisième fils, époux d’Andrée Rivier.
Marie Yvonne (Marie Yvonne Françoise Adrienne) Rivier (née à Melgven le 2 mai 1930), professeur d’économie puis d’anglais dans l’enseignement secondaire, a épousé à Melgven le 29 décembre 1953 André Thalouarn (né à Pont L’Abbé le 15 avril 1930, décédé), d’abord militaire dans l’armée de l’air, embauché dans l’entreprise Rivière, puis enseignant.
Après la mort de François Rivier en 1955, l’entreprise de bâtiment a été reprise par son fils Albert Rivier, gérant, et par son gendre Jean Kerhervé, engagé en septembre 1954 dans la société Rivière. Jean Cotten, frère d’Adrienne Cotten, y était chef d’atelier. A partir des années 1960, la société a eu pour actionnaires : Albert Rivier : 582 parts sur 1660 ; Jeanne Rivier épouse Scavennec : 499 parts ; Andrée Rivier épouse Kerhervé: 579 parts. L’entreprise a été vendue en juin 1983. Elle a fermé deux ans après.
LES GUERRES DE 1914-1918 ET 1939-1945
La guerre de 1914-1918
Il est rappelé que Louis Le Rivier et Marie Josèphe Postic (voir l’annexe I) sont notamment les parents de :
– Michel Rivier, cultivateur, père de Pierre, cultivateur, carrier, débitant de boissons, époux de Marie Corentine Postic;
– Pierre René Rivier, père de Pierre, entrepreneur en bâtiment, époux de Jeanne Carduner; et de Louis, entrepreneur et hôtelier, époux de Louise Guillou.
En ce qui concerne la famille de Michel Rivier, Pierre Rivier, cultivateur, débitant de boissons, fils de Michel, et son épouse Marie Corentine Postic sont les parents de : – Louis Pierre Marie Rivière (né à Rosporden le 6 avril 1894), caporal au 116e régiment d’infanterie, tué à l’ennemi à Perthes dans la Marne le 25 septembre 1915 ; – Jean Michel Rivière (né à Rosporden le 10 juillet 1897), soldat au régiment d’infanterie coloniale du Maroc, tué à l’ennemi à Louvemont dans la Meuse le 16 décembre 1916.
En ce qui concerne la famille de Pierre René Rivier, Pierre Rivier, fils de Pierre René, et son épouse Jeanne Marie Carduner, entrepreneurs en bâtiment, sont les parents de: – Perrine Rivière, qui a épousé Joseph Jean Marie Bourbigot (né à Melgven le 11 avril 1881), mort pour la France à Saint-Nicolas (62) le 16 juin 1915 ;
– Pierre Rivière, gazé et fait prisonnier par les Allemands (d’après sa fille Hélène); – Yves Rivière (Melgven /Kerscouarnec 10 avril 1890-Etinchem dans la Somme 1er août 1916), sergent au 69ème régiment d’infanterie, mort pour la France en 1916 ; – François (Michel François) Rivier, qui suit.
François (Michel François) Rivier a accompli 5 ans de services militaires, de 1913 à 1918, dont quatre au front, mobilisé au 50ème régiment d’artillerie. Le 16 novembre 1917, il a été cité à l’ordre du régiment : « Infirmier depuis le début de la campagne. A toujours fait preuve de la plus belle énergie et du plus entier dévouement. Le 9 novembre 1917, dans des circonstances particulièrement difficiles, a accompli son périlleux devoir avec un calme et un courage au-dessus de tout éloge » (lieutenant-colonel Salenave, commandant l’ACD/131). Son mariage a eu lieu en pleine guerre en 1917 à l’occasion d’une permission, et comme c’était la période du carême, le curé de Rosporden n’a pas voulu faire sonner les cloches. Le 25 avril 1918, il est à nouveau cité à l’ordre du régiment : « Infirmier modèle de dévouement et de bravoure. Gravement blessé le 16 avril 1918, à Villers Bretonneux, en exerçant ses fonctions auprès de nombreux blessés, officiers et canonniers du groupe. » (colonel O’Neill, commandant l’artillerie de la 131e division d’infanterie). 2e canonnier servant, infirmier à la 7e batterie du 50e régiment d’artillerie, il a été atteint à plusieurs parties du corps (plaie pénétrante au crâne, plaies aux deux jambes et au bras droit) lors d’un bombardement très intense. Il a été décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec palme. Réformé après trépanation, pensionné de guerre (avec un taux d’invalidité de 95 %), il a souffert de ses blessures sa vie durant.
On a vu précédemment que, lors de la guerre de 1914-1918, François Rivier a eu un frère tué et un autre gravement blessé, et que Perrine, sa sœur, y a perdu son mari.
Autres Rivier ou Rivière de cette famille, morts pour la France :
– Louis Pierre Marie Rivière (né à Rosporden le 6 avril 1894), caporal au 116e régiment d’infanterie, tué à l’ennemi à Perthes dans la Marne le 25 septembre 1915 ; – Jean Michel Rivière (né à Rosporden le 10 juillet 1897), soldat au régiment d’infanterie coloniale du Maroc, tué à l’ennemi à Louvemont dans la Marne le 16 décembre 1916. Ce sont deux petits-fils de Michel Rivier (Melgven 1822-Scaër 1878) et cousins de François Rivier (cousins issus de germains : voir ci-dessus le rappel des liens de parenté ; voir aussi l’annexe I).
La guerre de 1939-1945
Au printemps de 1943, François Rivier, contacté par le mouvement de Résistance Libération-Nord, rend visite à Robert Ricco, maréchal des logis, de la gendarmerie de Rosporden, pour lui proposer – ce qu’il accepte – de participer à ce mouvement, auquel adhère aussi le fils de François Rivier, Albert, incorporé en 1940 à l’Ecole du génie de Versailles, titulaire du brevet de préparation militaire supérieure, ingénieur des Arts et Métiers, incorporé au 404ème régiment d’artillerie et défense contre avions, ayant achevé son service militaire en zone libre dans ce qu’on appelait l’armée de l’armistice, et revenu à Rosporden en novembre 1942. Robert Ricco entraîne à sa suite la brigade de gendarmerie. Les actions de résistance consistent alors notamment à aider les réfractaires au STO, à transporter des armes, à assurer l’instruction militaire des jeunes résistants, à héberger des aviateurs. Des parachutages ont lieu dans la région de Rosporden. Au tout début de 1944, la famille Rivier cache un aviateur dont l’avion s’est écrasé. Elle cache aussi des armes.
Ce ne sont pas seulement François Rivier et son fils Albert qui ont pris part à la Résistance, mais l’ensemble de leur famille. A la suite d’un parachutage le 10 juillet 1944, c’est avec son beau-frère Jean Cotten que François Rivier, après avoir pris livraison d’un lot d’armes, a transporté ce chargement dans une charrette à bras à travers Rosporden. Les jeunes sœurs d’Albert, Andrée et Marie Yvonne, ont porté des messages. En juillet 2009, Marie Yvonne Rivier-Thalouarn a raconté qu’un jour de 1944, sa sœur Andrée et elle, porteuses d’un message – caché dans leur pot à lait- adressé par Albert Rivier au chef de la Résistance locale (le lieutenant d’infanterie Louis Le Cleac’h, alias « capitaine Mercier », gendre de M. Pennegues, gérant de l’usine Boutet à Rosporden/Coat-Canton), ont rencontré en chemin deux soldats allemands à vélo qui se sont arrêtés près d’elles, mais sont repartis sans les avoir autrement inquiétées.
Le 12 juillet 1944, les dirigeants des principaux groupes de résistants se rencontrent à la gendarmerie de Rosporden pour arrêter une stratégie commune. Il y a là Robert Ricco et Albert Rivier de « Libé-Nord », Jean Goarant des FTP (tué le 5 août 1944), Pierre Naour et René Gall (traiteur et fabricant de cidre, par la suite maire de Rosporden), de « Vengeance ». Ils se mettent d’accord pour confier le commandement commun au « capitaine Mercier », qui organise un bataillon FFI.
Ce bataillon est composé d’une section de commandement d’une soixantaine d’hommes (où se trouvent ceux qui sont chargés des transmissions, du ravitaillement, de l’infirmerie…) et de plusieurs compagnies. La section de commandement est dirigée par René Scavennec (Rosporden 15 septembre 1908-Quimperlé 27 avril 2007), maître-radio de la marine nationale (frère aîné d’André Scavennec qui s’est marié à Melgven le 9 août 1943 avec Jeanne Rivier fille de François: voir plus haut). En 1940, René Scavennec avait quitté Lorient pour rejoindre l’Afrique du nord. Puis, de Tunisie, il est revenu à Rosporden. Eugène Donal, journaliste, frère de sa femme, fait partie de sa section de commandement, ainsi que, par exemple, René Gall, traiteur et patron d’une cidrerie, futur maire de Rosporden. La première compagnie, d’environ 150 hommes, est commandée par Albert Rivier. La deuxième compagnie est d’abord commandée par Yves Le Corre, instituteur, qui, devenu second de « Mercier », est remplacé à la tête de cette compagnie par Pierre Le Naour, adjudant de carrière, démissionnaire de l’armée. Pierre Le Naour est tué le 5 août 1944. La troisième compagnie est dirigée par Robert Ricco.
Les Allemands avaient environ 150.000 hommes en Bretagne, et le souci des alliés était d’empêcher ces troupes de venir en renfort vers la Normandie. L’un des rôles assignés aux maquisards était de participer à cet objectif. Le 4 août 1944, les Américains entrent à Rennes, le 6 août ils atteignent Saint-Brieuc et Ploermel, le 6 ou le 8 août, ils sont à Vannes, le 10 août à Morlaix, Landerneau et Quimper, le 12 août à Nantes. Sur la côte sud du Finistère, la situation est plus problématique, car les Allemands refluent vers Lorient où ils sont décidés à tenir. Pour y parvenir, ils doivent passer par la région de Rosporden et de Quimperlé, où ont lieu plusieurs combats provoqués par l’arrivée de convois successifs tentant de gagner Lorient.
A Rosporden, le 2 août au soir, puis le 3 août à midi, le bataillon de Mercier capte un message de la BBC : « Le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec ? » C’est le signal de l’insurrection des maquisards. Mercier a pour objectif (et sans doute pour instruction) de couper l’axe Quimper-Lorient sur lequel se trouve Rosporden. Le 4 août 1944, les FFI tentent de libérer la ville. Les Allemands, qui ont perdu beaucoup d’hommes, incendient une soixantaine de maisons, et retiennent 32 otages, dirigés en train sur Lorient. A 5 km de cette ville, le convoi ferroviaire est attaqué par des chars américains. Les otages parviennent à s’enfuir, mais, pris entre les tirs allemands et américains, 9 d’entre eux sont tués et 2 autres grièvements blessés. A Rosporden, le maréchal des logis Robert Ricco est parvenu à hisser le drapeau tricolore sur la mairie. Une compagnie ennemie arrive dans la nuit, mais quitte rapidement Rosporden. On croit que la ville est libérée, mais le 5 août 1944, un autre convoi de camions allemands arrive. Le « capitaine Charron » (Carron de la Carrière), qui s’est réfugié derrière un mur près de la mairie, raconte : « A côté de moi, un officier marinier en tenue remplit les chargeurs de sa mitraillette Sten… Il marche à quatre pattes vers l’extrémité du mur, s’y dresse, tire ses rafales, revient vers moi toujours à quatre pattes, et tout en remplissant son chargeur, avec l’accent breton dit : « Ca chie, capitaine, gast ! » et il recommence. Quel brave, ce maître principal Scavennec ! ». Le 6 août 1944, un nouveau convoi de camions se présente, arrêté par René Scavennec et sa demi-douzaine d’hommes qui se trouvent dans la mairie. Voyant que les camions reculent, René Scavennec dévale l’escalier en hurlant « à l’assaut ». Il vide ses chargeurs sur l’ennemi qui crie au démon: « Der Teufel ! Der Teufel ! ». Les gendarmes Guéguen et Ricco arrivent en renfort, ainsi que René Gall, et les Allemands fuient en laissant sur les lieux trois camions et un matériel important. Le convoi n’ayant pu passer est obligé de prendre la direction de Pont-Aven. Les épisodes rospordinois de la Libération ont été mentionnés à la une du Figaro du 20 octobre 1944. L’article, de Jean Eparvier, est titré : « 25000 FFI bretons ont libéré eux-mêmes dix-neuf de leurs villes et continuent le combat. » Le 10 août 1944, le comité de libération de Rosporden est constitué, sous la présidence d’Albert Rivier, nommé par arrêté préfectoral le 31 août 1944 président de la délégation spéciale de Rosporden, tenant lieu de municipalité jusqu’aux élections de mai 1945 auxquelles il ne s’est pas présenté (il était domicilié à Melgven). Le 14 août 1944, onze soldats allemands capturés à Riec sont amenés à Rosporden, peut-être pour être interrogés. On croit, à tort ou à raison, qu’ils font partie de ceux qui ont brûlé soixante maisons lors des événements du 4 août. Le brigadier Ricco réussit à garder en prison l’un d’eux. Les autres sont exécutés chacun devant une maison brûlée. Albert Rivier, qui était à son domicile, se rend compte trop tard de ce qui se passe. Ces exécutions criminelles vont ternir le souvenir de la résistance rospordinoise.
Après les combats de Rosporden, les Allemands résistent à Concarneau, et parviennent à organiser une navette d’évacuation par bateaux vers Lorient. Les Américains sont arrivés, mais Lorient est aussi leur principal objectif, et ils se retirent de Concarneau le 20 août, laissant les FFI face à l’ennemi. René Scavennec participe à ces combats avec le capitaine Mercier. Ce n’est que le 25 août que Concarneau est libéré. Quant à l’encerclement de Lorient, auquel participe aussi René Scavennec, qui commande le corps-franc du premier bataillon « Rangers », il a duré neuf mois. Les Allemands résistent jusqu’au bout, et ne se rendent qu’au moment de la reddition de l’Allemagne, le 8 mai 1945. René Scavennec reçoit mission d’organiser à Ploemeur près de Lorient un camp d’un millier de prisonniers allemands.
Epilogue
Albert Rivier a repris l’entreprise familiale qu’il a dirigée jusqu’au début des années 1980. Il a été décoré de la croix de guerre (en 1959) et a été fait chevalier de la légion d’honneur (en 1982). Le 5 mai 2009, le conseil municipal de Rosporden a donné son nom à une nouvelle rue dans le « quartier de la Résistance » (ancienne ferme de la Villeneuve), rue inaugurée le 9 août 2009.
René Scavennec a rejoint l’Indochine, et participé au débarquement du Tonkin en 1946. Il a été cité à l’ordre de l’armée par le général Leclerc commandant des troupes françaises en Extrême-Orient, ainsi que par le général Koenig. Décoré de la croix de guerre, de la médaille militaire, de la médaille de la Résistance, de la croix de la légion d’honneur, il a terminé sa carrière dans la marine en 1958 avec le grade de maître principal.
ANNEXE I Présentation d’ensemble des Rivier descendants d’Yves Postic
Yves Postic (Scaër 19 juin 1754-Brest 22 mai 1794), ménager (sorte de laboureur), fils d’Yves, ménager, et de Marie Le Boedec, s’est marié à Bannalec le 27 novembre 1775 avec Marie Audren (décédée à Bannalec le 3 août 1803 à l’âge de 46 ans), fille de Guillaume et de Jeanne Le Mener. Administrateur du département du Finistère à partir de 1792, il a été guillotiné à Brest en 1794 comme la plupart de ses collègues de l’administration départementale.
Yves Postic et Marie Audren ont eu trois filles : Marie Jeanne, Marie Louise, Marie Josèphe.
Marie Jeanne Postic (Scaër 27 novembre 1781-Scaër 4 janvier 1819) a épousé à Scaër en secondes noces en 1806 René Ollivier (Scaër 1784-Scaër 1839), cultivateur. De ce second mariage est né René (René Yves) Ollivier, cultivateur, qui s’est marié à Bannalec en 1834 avec Jeanne (Le) Mener ; maire de Scaër d’août 1852 à mai 1862, René Ollivier a été juge de paix du canton de Scaër de 1865 à 1872.
Louise (Marie Louise) Postic (décédée à Bannalec le 29 décembre 1838 à l’âge de 52 ans) a épousé à Tourc’h le 4 juillet 1809 Joseph Pierre Gourmelen (Tourc’h 1782-Tourc’h 15 octobre 1860), cultivateur :
– fils de Joseph Pierre, élu député de la paroisse pour la rédaction du cahier de doléances de la sénéchaussée de Concarneau, secrétaire de la municipalité de Tourc’h en 1790, officier municipal en 1791 et 1792, priseur, maire de Tourc’h en 1794-1795, percepteur de la commune, charge qu’il exerçait toujours en 1799 ;
– et frère de Jean Gourmelen (né à Tourc’h/Penkerlijour, décédé à Tourc’h en 1868 à l’âge de 69 ans), cultivateur, maire de Tourc’h de 1844 à 1864, qui s’est marié à Tourc’h en 1826 avec Renée Le Quéré (décédée à Tourc’h en 1874).
La plus jeune des trois filles d’Yves Postic, Marie Josèphe Postic (Scaër/Keriquel 24 juin 1790-Tourc’h 2 mai 1850), a épousé à Tourc’h le 27 août 1809 Louis Le Rivier (Tourc’h/Kerannou 18 août 1790-Tourc’h/bourg 10 avril 1845), fils de Jean et de Marie Le Bouguennec. C’est Marie Josèphe qui, des trois, a vécu le plus longtemps, mais sa situation économique et sociale, surtout à la fin de sa vie, était précaire, alors que les familles de ses sœurs Marie Jeanne et Marie Louise faisaient partie des notables. Louis Le Rivier et Marie Josèphe Postic, après avoir exploité dans les années 1810 la ferme de Kerannou, s’installent à Scaër, puis reviennent à Tourc’h où leur fin de vie est difficile. A la date de leur décès, Louis le Rivier est journalier (en 1845), et Marie Josèphe Postic marchande de fruits (en 1850).
Louis Le Rivier et Marie Josèphe Postic sont les parents de plusieurs enfants nés à Tourc’h et à Scaër. Ceux qui se sont mariés sont : a) Jean, cultivateur ; b) Jacques, forgeron ; c) Michel, cultivateur ; d) Pierre René, maçon ; e) Louis, cultivateur.
a) Jean (Le) Rivier (Tourc’h/Kerannou 1811-Tourc’h/bourg 1854), cultivateur, s’est marié à Tourc’h en 1837 avec Marie (Marie Françoise) Begos ou Begot (Elliant 1810-Tourc’h/bourg 1871), cultivatrice ; domestique à Scaër/Keranguen lorsqu’il est témoin au décès en 1845 de sa sœur Marie Louise, il est cultivateur (domestique) à Quillien en 1850. De son mariage est né à Scaër le 17 décembre 1845 Jean Rivier qui s’est marié à Scaër le 7 juin 1870 avec Marie Jeanne Le Bec (née à Scaër le 12 mars 1848). b) Jacques Rivier (né à Tourc’h en 1815), forgeron, s’est marié à Rosporden en 1841 avec Marie Aline Thérèse Chiquet (née à Rosporden en 1822), fille d’Alain, maréchal-ferrant. D’après l’acte de naissance à Rosporden le 1er novembre 1860 de Marie Hyacinthe Rivier, fille des époux Rivier-Chiquet, le forgeron Jacques Rivier était alors détenu à Cayenne. c) Michel Rivier (Melgven 29 septembre 1822-Scaër 19 novembre 1878), cultivateur (domestique) à Kernével/Kervoalen en 1845, cultivateur à Scaër/Goarem en 1859, s’est marié à Elliant le 12 janvier 1853 avec Anne Le Boedec (Tourc’h 4 août 1814-Scaër 16 janvier 1878). Né de ce mariage, Pierre Rivier (né à Kernével le 6 octobre 1854) s’est marié à Rosporden le 19 juin 1883 avec Marie Corentine Postic (née à Rosporden le 26 mars 1865), cultivatrice, fille d’Alain et de Marie Josèphe Madiec (il s’agit de la famille Postic de la ferme de Kerannou à Tourc’h, dont sont issus également Laurent Postic, maire de Tourc’h de 1900 à 1904, et Joseph Postic, maire socialiste de Rosporden de 1935 à 1941 et de 1947 à 1953 ou 1959). Pierre Rivier, cultivateur, domicilié à Coray, a été témoin à la naissance de l’entrepreneur en bâtiment François Rivier à Melgven en 1892 ; cultivateur, domicilié à Rosporden, il a été témoin au mariage du même François Rivier à Rosporden en 1917 avec Adrienne Cotten. Il a été cultivateur, carrier, et une carte postale du début du XXe siècle montre qu’il a été aussi débitant de boissons à la sortie de l’église de Rosporden. Pierre Rivier et Marie Corentine Postic sont les parents de : – Pierre Marie Alain Rivier (né à Coray le 23 mars 1886), sellier; – Louis Pierre Marie Rivière (né à Rosporden le 6 avril 1894), caporal mort pour la France à Perthes dans la Marne le 27 septembre 1915 ; – Jean Michel Rivière (né à Rosporden le 10 juillet 1897), soldat mort pour la France à Louvemont dans la Meuse le 16 décembre 1916 ; – Marie Jeanne Anna Corentine Rivier (Rosporden 19 avril 1902-Rosporden 2 mars 1976), qui a épousé à Rosporden le 21 février 1922 Louis Marie Dubeau (probablement fils de Louis, employé du chemin de fer à Rosporden); – Anna Marie Joséphine Rivière (Rosporden 9 novembre 1904-Lyon le 8 février 1978). Après avoir résidé à Coray puis à Rosporden rue des vaches, les époux Rivier-Postic ont habité à Rosporden place de l’église où sont nés leurs filles en 1902 et 1904, ce qui permet de dater approximativement le moment où ils ont ouvert à cet endroit leur débit de boissons.
d) Pierre René Rivier (Scaër 3 avril 1825-Melgven 10 décembre 1874), maçon, s’est marié à Melgven le 29 juin 1853 avec Perrine Le Guiriec (voir plus haut).
e) Louis Rivier (Scaër 12 janvier 1828-Kernével 2 février 1888), cultivateur, s’est marié à Saint-Yvi le 21 avril 1858 avec Raimone Félixine Huon (Saint-Yvi 14 octobre 1830-Saint-Yvi/Kernevez 17 mai 1858). Il s’est marié en secondes noces à Kernével le 20 octobre 1858 avec Marie Jeanne Creo (née à Kernével en 1833 ou 1834), fille de René et de Marie Glémarec. Cultivateur à Kernével, il est le parrain de Louis Rivière (Melgven 1887-Quimper 1956), fils de Pierre et de Jeanne Carduner, entrepreneurs en bâtiment. Du mariage entre Louis Rivier et Marie Jeanne Creo sont nés à Saint-Yvi en 1859 Jean Louis (dont le parrain est son oncle Michel Rivier, âgé de 36 ans, cultivateur à Scaër/Goarem) et en 1861 René Marie (les témoins sont René Creo, âgé de 25 ans, cultivateur à Rosporden/Kerriou, parrain de l’enfant, et Pierre Rivier, âgé de 35 ans, maçon à Melgven/Cadol) : – Jean Louis Rivier (né à Saint-Yvi le 22 octobre 1859), aide cultivateur (journalier en 1883), domicilié à Melgven, s’est marié à Melgven le 15 novembre 1882 avec Marie Philomène Le Cam (née à Nizon le 5 juillet 1859), aide-cultivatrice; l’un des témoins a été Pierre Rivier, cousin du marié ; de ce mariage est née Marie Jeanne Philomène Rivier (Rosporden 12 août 1883-Kernével 24 octobre 1976) qui a épousé à Kernével le 10 septembre 1901 Louis Corentin Marie Sancéau ; – René Marie Rivier (né à Saint-Yvi le 29 janvier 1861), cultivateur, domicilié à Rosporden, sachant signer, s’est marié à Rosporden le 7 mai 1889 avec Marie Hélène Troalen (née à Elliant le 17 janvier 1865), cultivatrice, domiciliée à Rosporden.
ANNEXE II Louis Rivière, entrepreneur et hôtelier
Pierre René Rivier et Perrine Le Guiriec sont les parents de :
– Pierre, dont sont issus les Rivier entrepreneurs en bâtiment;
– Louis, qui suit.
Frère de l’entrepreneur en bâtiment Pierre Rivier, Louis Rivière (né à Melgven/Pontinao le 16 septembre 1865) s’est marié à Rosporden le 22 janvier 1890 avec Louise (Marie Louise Françoise) Guillou (Rosporden/Kerlue Bras 22 août 1864-Rosporden 23 janvier 1950), fille de cultivateurs. Sœur de Louise Guillou qui a épousé Louis Rivière, et qui a été hôtelière de l’Hôtel de la gare à Rosporden, Anne Perrine Ursule Guillou, qui a épousé à Rosporden en 1882 Hervé Pierre Flatrès, maréchal ferrant, a été hôtelière de l’hôtel Flatrès voisin de l’Hôtel de la gare.
Louis Rivière, cultivateur jusqu’en 1893-1895, a été ensuite entrepreneur (encore qualifié ainsi dans l’acte de naissance de sa fille Georgette en 1903) et hôtelier (Hôtel de la gare). Président de l’ASR, l’Association Sportive Rospordinoise (d’inspiration laïque face à l’autre club sportif de la commune, l’Etoile, avec lequel elle a fini par fusionner en 1998), il a donné son nom à un stade de Rosporden.
Louis Rivière et Louise Guillou sont les parents d’au moins huit enfants nés à Rosporden de 1890 à 1905, dont six ont atteint l’âge adulte:
– Louise Renée Perrine Anna Rivière (Rosporden 27 novembre 1891-Paris 16ème 17 mars 1970), dont la naissance a été déclarée en présence notamment de Pierre Rivier, oncle paternel de l’enfant) ; Louise Rivière a épousé à Port-Louis le 16 février 1925 Corentin Nicolas Coïc, hôtelier (de l’« Hôtel de la mer » à Port-Louis); de ce mariage est née Yvonne Coïc, qui a épousé un militaire devenu général ;
– Louis (Louis René Toussaint) Rivière (né à Rosporden au lieudit « La métairie » le 31 octobre 1893); Louis Rivière, dit « petit Louis », ingénieur, aurait été prisonnier de guerre et se serait échappé, mais il est mort le 8 novembre 1914 ?;
– Marie Isabelle Rivière (née à Rosporden rue de Quimper le 25 octobre 1895, dont la naissance a été déclarée en présence de Hervé Flatrès et de Jérôme Guillou), qui a épousé à Rosporden le 24 juillet 1928 Antoine Bordet ;
– Anne (Joséphine Elisa Jeanne Perrine Anna) Rivière (née à Rosporden rue de Quimper le 22 octobre 1898), qui a épousé à Rosporden le 30 août 1921 Georges Julien Marie Pober (Rosporden 15 août 1896-Concarneau 16 septembre 1977), décoré de la légion d’honneur, fils de Corentin Hilaire, jardinier à Rosporden/Parc An Breach, et de Marie Noëlle Le Breton; Anne Rivière ou son mari, ou les deux, étaient instituteurs ; Georges Julien Marie Pober s’est marié en secondes noces à Concarneau le 19 décembre 1934 avec Marie Josèphe Françoise Lardic ;
– Marie Anne Josèphe Eulalie Rivière (née à Rosporden/avenue de la gare le 6 janvier 1901) ; c’est à partir de cette naissance que les enfants des époux Rivière-Guillou sont nés à l’adresse de l’Hôtel de la gare ;
– Georgette (Georgette Louise Joséphine) Rivière (Rosporden/avenue de la gare 18 mars 1903-Rosporden 17 septembre 1973), qui a épousé à Rosporden le 19 septembre 1935 Henri Charles Patrice Contamine.
D’après une carte postale des années 1930, l’Hôtel de la gare était alors géré par les époux Bordet-Rivière. Au milieu des années 1930, les Rivière ont vendu l’Hôtel de la gare à la veuve de Corentin (Corentin Jean Pierre) Bourhis (né à Rosporden le 10 novembre 1888, décédé le 2 septembre 1934 à 46 ans), qui s’est marié à Rosporden le 5 octobre 1918 avec Marie (Marie Louise Catherine) Nédelec (Saint-Yvi 18 juillet 1895-Rosporden 4 novembre 1975), fille de Jean Louis, cultivateur, et de Corentine Vincourt, ménagère. Corentin Bourhis est un frère de Joséphine (Joséphine Marie Louise Victorine) Bourhis (née à Rosporden le 12 janvier 1891, décédée en 1975), qui a épousé à Rosporden le 1er octobre 1912 Jean (Jean Marie) Nicolas (1888-1975), de Scaër/Cleumerrien, charpentier, devenu courtier en petits pois, puis industriel conserveur à Rosporden. Enfants de Corentin Bourhis et de Marie Nédelec :
– Agnès Bourhis a épousé son cousin germain le docteur René Nicolas (fils des époux Nicolas-Bourhis);
– Marcel Bourhis a repris l’hôtel, et a eu comme successeur son fils à la tête de cet établissement encore dénommé « Hôtel Bourhis » au milieu des années 1990, signalé sous ce nom dans le guide Michelin de cette époque, avant qu’il ne soit vendu par la famille Bourhis.
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
Centre généalogique du Finistère : Base de données Recif Site internet SGA/mémoire des hommes (morts pour la France) Site interne Leonore (base de données pour la légion d’honneur) Inscriptions des cimetières
CAMBRY (Jacques): Voyage dans le Finistère, Paris, an VII (gallica, site internet de la BNF) DELUMEAU (Jean), sous la direction de : Histoire de la Bretagne, Editions Privat, 1987 DENIS (Michel) et GESLIN (Claude) : La Bretagne des blancs et des bleus (1815-1880), Editions Ouest-France, 2003 DOUGUET (Jean-François): Elliant, Tourc’h, deux communes dans la Révolution, chez l’auteur, Imprimerie régionale, Bannalec, 1991 DUPUY (Roger): La Bretagne sous la Révolution et l’Empire (1789-1815), Editions Ouest France, 2004 GUIRIEC (Henri) : Rosporden, histoire de la paroisse, 1951, Réédition, Le livre d’histoire-Lorisse éditeur, Paris 2003 LE GALLO (Yves) sous la direction de : Le Finistère, de la préhistoire à nos jours, Editions Bordessoules, 1991 LE MAITRE (Louis-Pierre) : Les sillons de Beuzec, au pays de Concarneau, Imprimerie Bargain à Quimper, seconde édition, 1976 MAGUER (Cyrille ): Chroniques du pays de Concarneau, Editions Alain Sutton, 2006 MAGUER (Cyrille) : Rosporden, collection « Mémoire en images », Editions Alain Sutton, 2007 MAGUER (Cyrille) : Le canton de Scaër, collection « Mémoire en images », Editions Alain Sutton, 2008 SAVINA (Jean) et BERNARD (Daniel) : Cahiers de doléances des sénéchaussées de Quimper et de Concarneau pour les Etats généraux de 1789, publiés et annotés par ces deux auteurs (Collection de documents inédits sur l’histoire économique dela Révolution française publiés par le ministère de l’instruction publique), Rennes, imprimerie Oberthur, 1927
Pour la période de la guerre de 1939-1945, les sources utilisées ont été principalement: LE BARILLEC (Bertrand): Les talus de la révolte, 1966; LE BARILLEC (Bertrand): 8 septembre 1939. Cette nuit nous entrons en Allemagne, chez l’auteur, 2000; QUENEHERVE (Christian): Combattants de l’ombre en Cornouaille, 1989