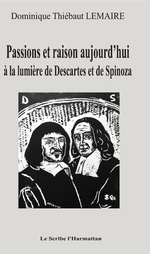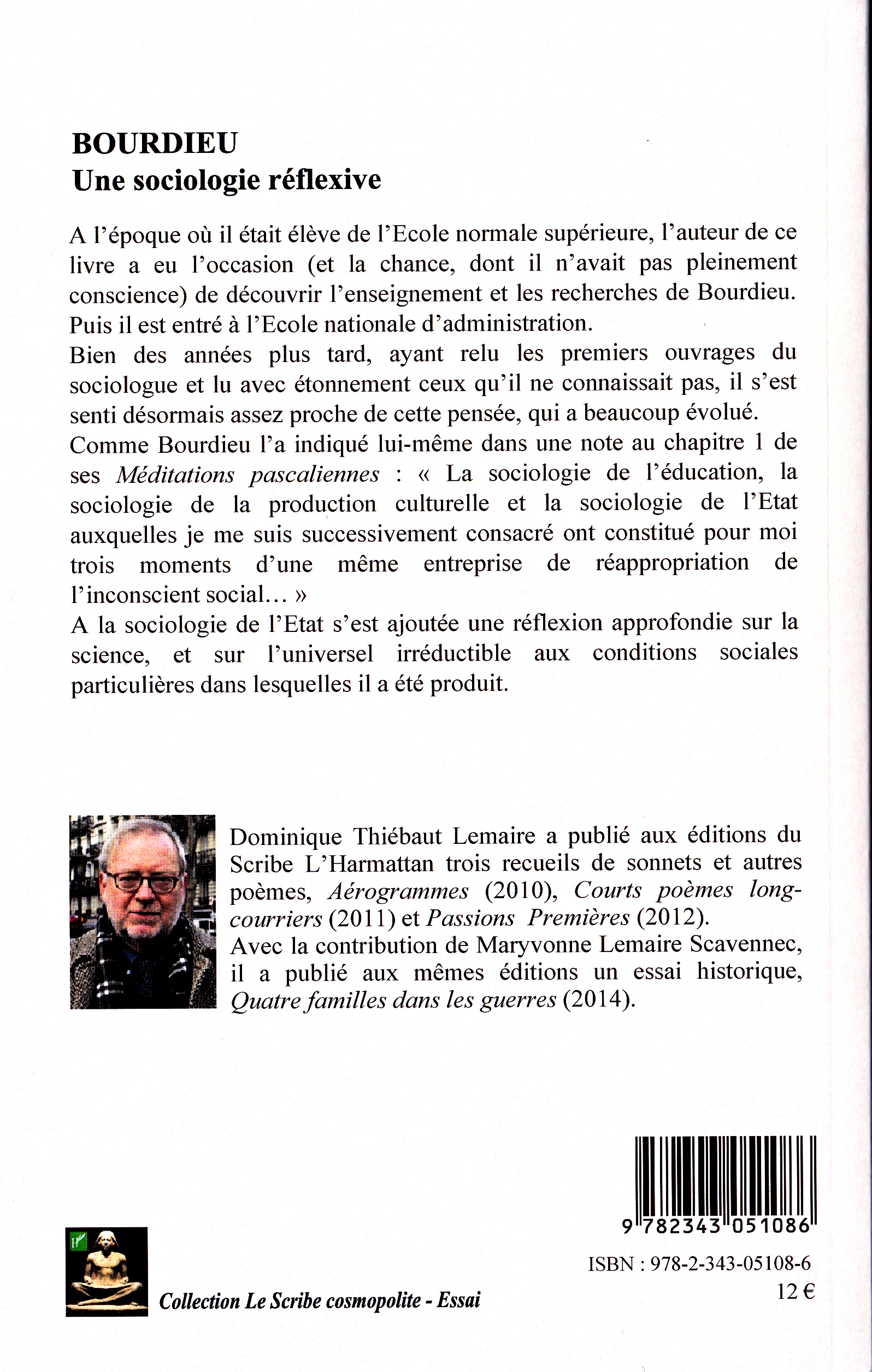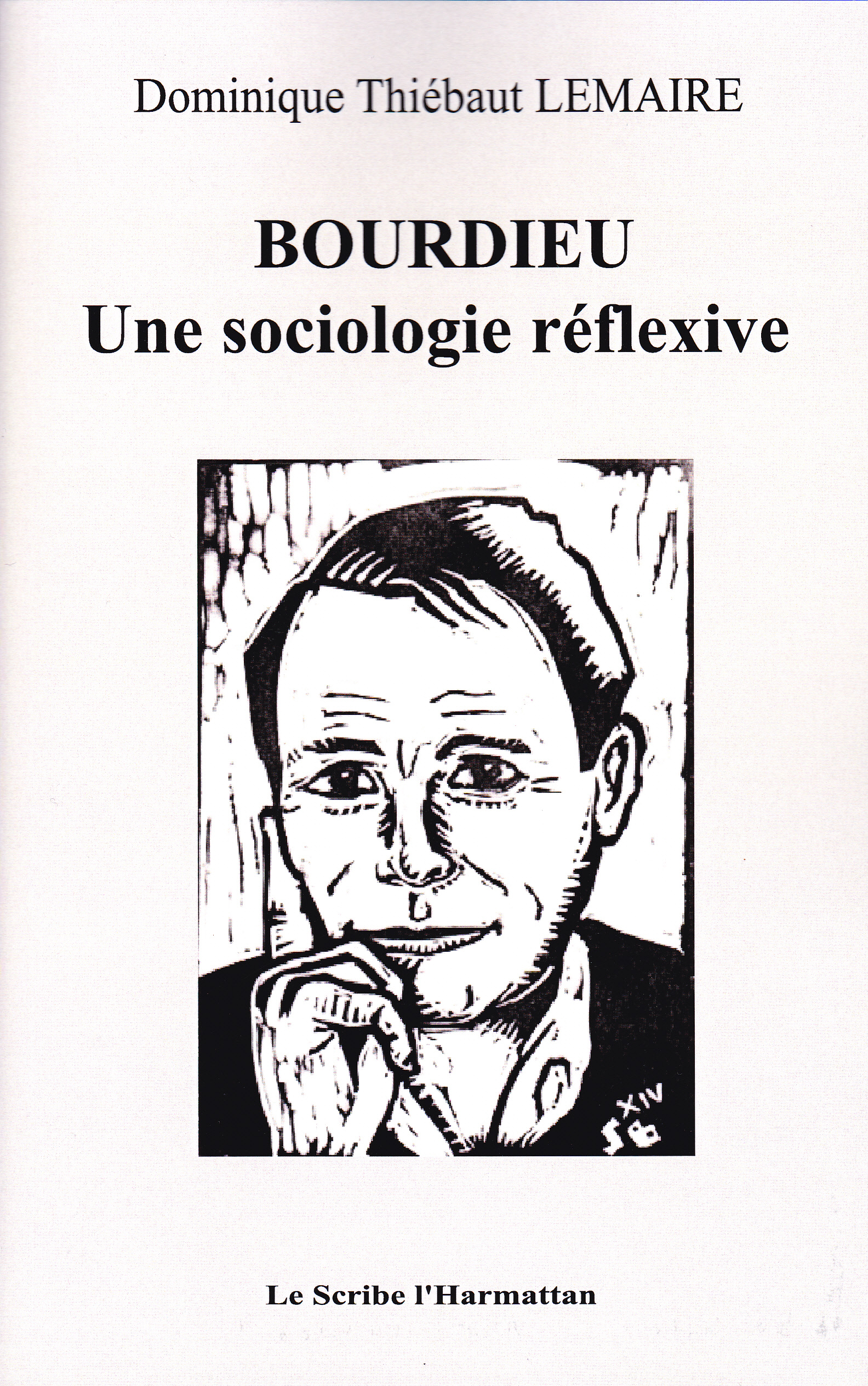Version résumée
Pierre Bourdieu (1930-2002), élève de l’Ecole normale supérieure de 1951 à 1954, agrégé de philosophie en 1954, directeur d’études à l’École des Hautes Etudes de 1964 à 2001, est devenu en 1982 professeur de sociologie au Collège de France où il a enseigné jusqu’à sa retraite en 2001. Il a reçu la médaille d’or du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en 1993. La fin de son parcours a été marquée par sa consécration nationale et internationale de grand intellectuel engagé.
LE PARCOURS DE L’OEUVRE
Bourdieu a distingué lui-même plusieurs étapes dans son œuvre :
« La sociologie de l’éducation, la sociologie de la production culturelle et la sociologie de l’Etat auxquelles je me suis successivement consacré ont ainsi constitué pour moi trois moments d’une même entreprise de réappropriation de l’inconscient social qui ne se réduit pas aux tentatives déclarées d’ « auto-analyse »… (Méditations pascaliennes, chapitre 1, note 2, page 356).
S’agissant de la sociologie de l’éducation, les Héritiers (1964), livre écrit avec Jean-Claude Passeron, a connu un grand succès public. C’est en pensant d’abord à ce livre que Bourdieu a écrit en 1997 : « Les découvertes les plus indiscutables, comme l’existence d’une forte corrélation entre l’origine sociale et la réussite scolaire ou entre le niveau d’instruction et la fréquentation des musées, ou encore entre le sexe et les probabilités d’accès aux positions les plus valorisées des univers scientifique ou artistique, peuvent être refusées comme des contre-vérités scandaleuses… Dans la mesure où son travail d’objectivation et de dévoilement le conduit en maintes occasions à produire la négation d’une dénégation, le sociologue doit s’attendre à ce que ses découvertes soient à la fois annulées ou rabaissées comme des constats triviaux, connus de toute éternité, et violemment combattues, par les mêmes, comme des erreurs notoires… » (Méditations pascaliennes, chapitre 5, « violence symbolique et luttes politiques », sous-chapitre intitulé « La double vérité », p.274).
Les analyses des Héritiers, fondées notamment sur des statistiques de l’INSEE par catégories socioprofessionnelles, sans doute peu adéquates pour une étude avec précise des origines sociales et de la « domination » (comme les auteurs l’admettent en partie dans La Reproduction), ont eu des effets négatifs sur la manière de penser le système d’enseignement dans la société française, comme système reproducteur des inégalités plutôt que des connaissances. Elles ont eu aussi des effets négatifs sur la réputation même de Bourdieu, auquel on a collé l’étiquette de « déterministe», alors qu’il s’est efforcé de concilier déterminisme et liberté.
Un autre livre célèbre de Bourdieu, La Distinction, fruit d’un effort considérable d’enquêtes et de réflexion, présente une grande richesse d’informations concrètes, mais celles-ci ont souffert d’une péremption historique rapide, comme l’auteur l’a reconnu, de sorte que les leçons que l’on peut finalement en tirer doivent faire abstraction de leur caractère daté (par exemple, les goûts à un certain moment ne sont pas des propriétés substantielles inscrites dans une sorte d’essence culturelle, mais des propriétés relationnelles qui n’existent que par la relation avec les goûts d’autres individus ou groupes sociaux ; autre leçon générale, les choix dans les domaines les plus différents de la pratique, en cuisine, en sport, en musique, en politique, sont liés entre eux de manière relativement cohérente).
Après la sociologie de l’éducation puis celle de la production culturelle, Bourdieu a consacré des développements importants, à partir de la fin des années 1980, à la sociologie de l’Etat et au thème de l’universel.
Il a été plus que bien d’autres, sans doute, un homme de contradictions, ce qu’il a fini par assumer consciemment, en parlant de son « habitus clivé » de grand universitaire issu d’un milieu modeste, et en développant des analyses qui font apparaître la société comme un monde double, à la fois économique et non économique.
UNE SOCIOLOGIE REFLEXIVE
Bourdieu a voulu être un « sociologue réflexif » : sujet et objet de ses analyses. La leçon inaugurale qu’il a prononcée au Collège de France en 1982 illustre cette démarche. Intitulée Leçon sur la leçon, elle est présentée par son auteur comme un « discours qui se réfléchit lui-même » où l’auteur commence par rappeler « une des propriétés les plus fondamentales de la sociologie telle que je la conçois : toutes les propositions que cette science énonce peuvent et doivent s’appliquer au sujet qui fait la science » (p. 8-9).
Ce thème a fait l’objet de son dernier cours au Collège de France (2000-2001) publié en 2002 sous le titre Science de la science et réflexivité, dont le chapitre 3 s’intitule : «Pourquoi les sciences sociales doivent se prendre pour objet ».
« Lorsque je soumettais à l’examen, sans ménagements, a-t-il reconnu, le monde dont je faisais partie, je ne pouvais pas ne pas savoir que je tombais nécessairement sous le coup de mes propres analyses, et que je livrais des instruments susceptibles d’être retournés contre moi : la comparaison de l’arroseur arrosé, que l’on emploie en pareil cas, désignant simplement une des formes, très efficace, de la réflexivité telle que je la conçois » (Méditations pascaliennes, introduction, p.13).
QUELQUES CONCEPTS MAJEURS
Sous cette rubrique, on se propose de présenter la pensée du sociologue en centrant cette présentation sur quelques-uns de ses concepts : inconscient social, habitus, champs ou microcosmes. Autre concept majeur, celui de « domination » est expliqué et illustré plus loin à propos du symbolique.
L’inconscient social
Du début à la fin de son œuvre, Bourdieu a insisté sur le caractère caché des mécanismes sociaux, en employant un vocabulaire souvent proche de celui de la psychanalyse : inconscient social, dénégation, refoulement,retour du refoulé…
Le premier axiome, numéroté 0, de La Reproduction (1970), livre écrit avec Jean- Claude Passeron et dont la première partie est présentée more geometrico à la façon de Spinoza, s’énonce ainsi :
« Tout pouvoir de violence symbolique, i.e. tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force, ajoute sa force propre à ces rapports de force » (p. 18).
On peut citer aussi la Leçon sur la leçon (1982), qui parle des « ténèbres de la méconnaissance »:
« …la connaissance exerce par soi un effet – qui me paraît libérateur – toutes les fois que les mécanismes dont elle établit les lois de fonctionnement doivent une part de leur efficacité à la méconnaissance, c’est-à-dire toutes les fois qu’elle touche aux fondements de la violence symbolique. Cette forme particulière de violence ne peut en effet s’exercer que sur des sujets connaissants, mais dont les actes de connaissance, parce que partiels et mystifiés, enferment la reconnaissance tacite de la domination qui est impliquée dans la méconnaissance des fondements vrais de la domination. On comprend que la sociologie se voie sans cesse contester le statut de science, et d’abord évidemment par tous ceux qui ont besoin des ténèbres de la méconnaissance pour exercer leur commerce symbolique » (p.20-21).
Et :
« Une bonne part de ce que le sociologue travaille à découvrir n’est pas caché au même sens que ce que les sciences de la nature visent à porter au jour. Nombre des réalités ou des relations qu’il met à découvert ne sont pas invisibles, ou seulement au sens où « elles crèvent les yeux», selon le paradigme de la lettre volée cher à Lacan… » (Leçon sur la leçon, p. 30-31).
Les champs ou microcosmes sociaux
Bourdieu conçoit le monde social comme un ensemble de «champs» qu’il dénomme aussi « microcosmes ». Pour lui, « les champs sociaux sont des champs de forces mais aussi des champs de luttes pour transformer ou conserver ces champs de forces » (Leçon sur la leçon, p.46).
Comme on l’a déjà vu, il a étudié plus particulièrement les champs de l’enseignement, de la production intellectuelle et de l’Etat, dans l’ordre de la connaissance (ou de la science), dans l’ordre de l’éthique (ou du droit, et de la politique), et dans l’ordre de l’esthétique (la littérature, l’art) : voir ses Méditations pascaliennes, début du chapitre 2, « Les trois formes de l’erreur scolastique », p. 76.
Un essai de généralisation pour la constitution d’une théorie des champs à partir des champs artistiques et culturels se trouve dans Les règles de l’art (deuxième partie, p.351 et suivantes).
Pour caractériser un champ selon Bourdieu, la notion d’autonomie est importante. La loi ou nomos de chaque champ peut s’énoncer sous la forme d’une tautologie significative de sa clôture: « c’est particulièrement visible dans le cas du champ artistique dont le nomos tel qu’il s’est affirmé dans la seconde moitié du XIXe siècle (« l’art pour l’art ») est l’inversion de celui du champ économique (« les affaires sont les affaires ») » (Méditations pascaliennes, p.139).
Les champs ont chacun leur nomos (leur loi) et leur type d’illusio (croyance dans le jeu). Chacun d’eux enferme les agents dans ses enjeux propres qui, du point de vue d’un autre jeu, peuvent être considérés comme insignifiants :
« Chacun sait par expérience que ce qui fait courir le haut fonctionnaire peut laisser le chercheur indifférent et que les investissements de l’artiste restent inintelligibles pour le banquier. C’est dire qu’un champ ne peut fonctionner que s’il trouve des individus socialement prédisposés à se comporter en agents responsables, à risquer leur argent, leur temps, parfois leur honneur ou leur vie, pour poursuivre les enjeux et obtenir les profits qu’il propose et qui, vus d’un autre point de vue, peuvent paraître illusoires…» (Leçon sur la leçon, p 47).
L’habitus
L’habitus désigne chez Bourdieu un ensemble inculqué, inconscient et pour une large part incorporé au corps, de « dispositions durables et transposables qui, intégrant toutes les expériences passées, fonctionne à chaque moment comme une matrice de perceptions, d’appréciations et d’actions, et rend possible l’accomplissement de tâches infiniment différenciées » (Esquisse d’une théorie de la pratique, p. 261).
Dans ses Méditations pascaliennes, Bourdieu a commenté cette notion :
« Le concept d’habitus a pour fonction primordiale de rappeler fortement que nos actions ont plus souvent pour principe le sens pratique que le calcul rationnel ; ou que… le passé reste présent et agissant dans les dispositions qu’il a produites ; ou encore que, contre la vision atomistique que propose certaine psychologie expérimentale, attachée à analyser des aptitudes ou des attitudes séparées (esthétiques, affectives, cognitives, etc.) et contre la représentation (authentifiée par Kant) qui oppose les goûts nobles, dits « purs », et les goûts élémentaires, ou alimentaires, les agents sociaux ont, plus souvent qu’on ne pourrait s’y attendre, des dispositions (des goûts par exemple) plus systématiques qu’on ne pourrait le croire. » (Méditations pascaliennes, chapitre 2, « Les trois formes de l’erreur scolastique », sous-chapitre intitulé « Digression. Critique de mes critiques », p. 94-95).
« Une des fonctions majeures de la notion d’habitus est d’écarter deux erreurs complémentaires qui ont toutes les deux pour principe la vision scolastique : d’un côté, le mécanisme, qui tient que l’action est l’effet mécanique de la contrainte de causes externes ; de l’autre, le finalisme qui … tient que l’agent agit de manière libre, consciente et, comme disent certains utilitaristes, with full understanding…» (Méditations pascaliennes, chapitre 4, « La connaissance par corps », sous chapitre intitulé « Habitus et incorporation », p. 201-201).
Bourdieu a insisté notamment sur deux aspects: Le caractère « corporel » de l’habitus ; et le lien entre habitus et champ social.
En ce qui concerne le caractère corporel de l’habitus, il insiste sur ce point de façon quelque peu surprenante, comme si l’habitus n’était pas aussi une disposition de l’esprit. Peut-être s’agissait-il de remplacer par le mot « corps » ceux de « personne » ou « individu » jugés inadéquats, trop idéalistes ou trop « individualistes ». L’importance donnée au corps est peut-être due aussi à l’influence de Blaise Pascal et de ses trois ordres : la chair, l’esprit, la volonté (voir plus loin ce qui est dit sur « une philosophie pascalienne »).
En ce qui concerne le lien entre habitus et champ/microcosme, Bourdieu explique dans sa Leçon sur la leçon (P 37-38) l’importance de la relation « entre l’histoire objectivée dans les choses, sous la forme d’institutions, et l’histoire incarnée dans les corps, sous la forme de ce que j’appelle l’habitus ». Il considère comme une rupture décisive par rapport au mode de pensée traditionnel « le fait de substituer à la relation naïve entre l’individu et la société la relationconstruite entre ces deux modes d’existence du social, l’habitus et le champ, l’histoire faite corps et l’histoire faite chose. »
Déterminisme et liberté
Bourdieu a été accusé d’être excessivement déterministe, bien qu’il ait proposé plusieurs perspectives de liberté:
– En reprenant le raisonnement philosophique classique selon lequel la liberté tient
d’abord à la mise en évidence et à la juste connaissance des déterminations sociales et autres;
– En montrant comment l’autonomie des différents champs ou microcosmes peut favoriser l’indépendance d’esprit et une sorte de séparation des pouvoirs ;
– En développant l’idée qu’entre les causes externes et les agents sociaux exposés à ces causes externes s’interposent non seulement le microcosme, mais aussi
l’habitus, qui font écran à une causalité automatique ;
– En prenant en considération l’autonomie relative de l’ordre symbolique (voir ci-dessous) ; le pouvoir symbolique, par l’évocation plus ou moins inspirée et exaltante de l’avenir – prophétie, pronostic ou prévision – peut introduire un certain jeu dans la correspondance entre les espérances et les chances et ouvrir un espace de liberté par la présentation de possibles plus ou moins improbables, utopie, projet, programme ou plan, que la logique des probabilités conduirait à tenir pour pratiquement exclus.
LE SYMBOLIQUE
Le mot « symbolique » appartient aussi à la psychanalyse lacanienne (distinguant le réel, l’imaginaire et le symbolique), mais Bourdieu lui donne un sens différent, qui se rapproche de celui que l’on trouve dans les expressions « franc symbolique de dommages et intérêts » ou « geste symbolique » : un geste qui, tout en étant réel, tire sa valeur du fait qu’il est signe d’autre chose. Le symbolique selon Bourdieu ne se comprend pleinement qu’en opposition avec d’autres termes, principalement en opposition avec ce qu’il appelle « l’économie économique », mais en association avec plusieurs autres mots (biens, capital, force, lutte, pouvoir, révolution, violence…).
Tout en distinguant le symbolique de l’économie, Bourdieu semble avoir pris un malin plaisir à les associer dans l’expression « économie des biens symboliques » (où, il est vrai, le mot « économie » est pris dans son sens d’organisation, structure des éléments d’un ensemble, plutôt que dans le sens de production et consommation des richesses matérielles).
La domination
Le symbolique est pour lui un élément essentiel de la domination, concept sur lequel il a fondé une grande partie de sa réflexion sociologique qui distingue « dominants » et « dominés ». On peut trouver un peu sommaire cette distinction, mais il l’a rendue complexe en analysant en profondeur ce qui est essentiel dans le couple dominant-dominé, c’est-à-dire non pas le dominant, ni le dominé, mais la relation entre eux, qui ne repose jamais uniquement sur la force nue, celle des armes ou de l’argent, et qui ne peut fonctionner vraiment que par le symbolique.
L’un des effets de la violence symbolique est la transfiguration des relations de domination en relations affectives, la transformation du pouvoir en charisme ou en charme dans un paradoxe apparent unissant soumission et « enchantement » affectif. Les rapports d’exploitation qui en résultent ne fonctionnent que s’ils sont doux.
Bourdieu est revenu sur ce sujet dans ses Méditations pascaliennes : « La violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il
ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée de la structure de la relation de domination,font apparaître cette relation comme naturelle … Le pouvoir symbolique ne s’exerce qu’avec la collaboration de ceux qui le subissent…
La domination, même lorsqu’elle repose sur la force nue, celle des armes ou de l’argent, a toujours une dimension symbolique et les actes de soumission, d’obéissance, sont des actes de connaissance et de reconnaissance » (Méditations pascaliennes, chapitre 5, « Violence symbolique et lutte politiques », sous-chapitre « Le pouvoir symbolique », p. 246-248).
Les propriétés de l’économie des biens symboliques
Les propriétés (appelées ici caractéristiques) de l’économie des biens symboliques selon Bourdieu sont résumées à la fin du chapitre 6 de Raisons pratiques.
Première caractéristique : il s’agit de pratiques qui ont toujours des vérités doubles, économiques et non économiques.
Deuxième caractéristique : le tabou de l’explicitation, la forme par excellence de l’explicitation étant le prix.
Troisième caractéristique : les agents dépensent beaucoup d’énergie dans l’échange symbolique. C’est une des raisons pour lesquelles l’économie économique est beaucoup plus économique. Par exemple, quand au lieu de faire un cadeau adapté aux goûts du destinataire, on fait un chèque, on s’économise les efforts nécessaires pour que le cadeau convienne à la personne, et les efforts nécessaires pour que sa valeur ne soit pas directement réductible à l’argent.
Autres caractéristiques : la dénégation, le refoulement de l’économie économique ne peut réussir que parce qu’ils sont fondés sur une sorte de méconnaissance collective partagée, produit d’une socialisation conduisant à l’incorporation des structures objectives du marché des biens symboliques, sous la forme de structures cognitives accordées avec ces structures objectives.
Les domaines où s’épanouit le symbolique
Les domaines de prédilection du symbolique sont :
– Les relations où s’exerce la domination masculine, en particulier dans la famille ;
– L’enseignement ;
– Le monde du religieux et du caritatif ;
– Les relations de travail ;
– L’art et la culture ;
– La politique…
L’UNIVERSEL
En première approche, on peut définir l’universel selon Bourdieu de la manière suivante: quelque chose qui, bien que socialement produit, n’est pas réductible aux conditions particulières de sa production, dans le domaine de la science, mais aussi dans le domaine de l’éthique, de l’Etat et du droit, où il s’agit par exemple d l’universel des « valeurs » de la démocratie et des droits de l’homme, dans lesquelles il englober de grandes notions administratives : l’intérêt général, le service public…
Bien qu’il n’approfondisse pas cette question, on peut se demander dans quelle mesure l’universalité de ces valeurs est égale à celle de la science. Par exemple, le caractère universel de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 par l’Organisation des Nations Unies a été discuté dans le cadre de cette organisation.
Dans une première étape de sa démarche, l’étape de ce qu’il a appelé la « critique du soupçon », inspirée du marxisme, il a considéré l’universel surtout comme un faux- semblant destiné à masquer, en même temps qu’à mieux faire prévaloir, les intérêts particuliers de ceux qui l’invoquent. Par la suite, il a nuancé sa réflexion. Pour caractériser le dernier état de sa
pensée, on peut dire que:
– L’universalisation y est une réalité à double face, à la fois monopolisation dominatrice et évolution positive;
– Il existe un « intérêt au désintéressement » ;
– Il est possible à la fois de lutter contre l’hypocrisie de l’universalisme abstrait et pour l’accès aux conditions de l’universel.
L’universalisation : impérialisme mais aussi progrès
Le développement de l’Etat moderne, dont fait partie le système scolaire, est une réalité à double face : progrès vers un degré d’universalisation supérieure (délocalisation, dé-particularisation, etc.) et, dans le même mouvement, évolution vers la monopolisation la concentration du pouvoir, donc vers la constitution des conditions d’une domination centrale…
« L’avènement de la raison est inséparable de l’autonomisation progressive de microcosmes sociaux fondés sur le privilège, où se sont peu à peu inventés des modes de pensée et d’action théoriquement universels mais pratiquement monopolisés par
quelques-uns…
La même ambiguïté s’observe dans la relation entre les nations dominantes et les nations dominées – ou les provinces et les régions annexées à l’Etat central, à sa langue, à sa culture, etc. C’est ainsi que ceux qui ont porté l’Etat (français) à un degré d’universalité supérieur à celui de la plupart des nations contemporaines (avec le code civil, le système métrique, la monnaie décimale et tant d’autres inventions « rationnelles »), les révolutionnaires de 1989, ont immédiatement investi leur foi universaliste dans un impérialisme de l’universel placé au service d’un Etat national (ou nationaliste) et de ses dignitaires » (Méditations pascaliennes, chapitre 2 : « Les trois formes de l’erreur scolastique », sous-chapitre intitulé : « L’ambiguïté de la raison », p. 113).
« Si l’universel avance, c’est parce qu’il existe des microcosmes sociaux qui, en dépit de leur ambiguïté intrinsèque, liée à leur enfermement dans le privilège et l’égoïsme satisfait d’une séparation statutaire, sont le lieu de luttes qui ont pour enjeu l’universel… (Méditations pascaliennes, chapitre 3 : «les fondements historiques de la raison », sous-chapitre intitulé : « L’universalité des stratégies d’universalisation », p. 178-179).
L’intérêt au désintéressement
On peut tenir « pour une loi anthropologique universelle qu’il y a du profit (symbolique et parfois matériel) à se soumettre à l’universel… », écrit Bourdieu dans Raisons pratiques (considérations finales intitulées « Un fondement paradoxal de la morale », p.234-235). Et: « la sociologie des intellectuels fait découvrir cette forme particulière d’intérêt qu’est l’intérêt au désintéressement » (Science de la science et réflexivité, p.183-184).
La sociologie, dit-il, doit expliquer la constitution d’univers sociaux où s’engendre « du transhistorique ». » Ce n’est pas parce que certains agents ont intérêt socialement s’approprier cet universel que cet universel n’est pas universel » (Raisons pratiques, chapitre 5, transcription de deux cours du collège de France donnés à Lyon en décembre 1988 ; cours du Collège de France en 1988-1989 ; cours Sur l’Etat du 15 février 1990, p. 159).
La lutte pour l’accès à l’universel
« Il n’y a pas de contradiction, en dépit des apparences, à lutter à la fois contre l’hypocrisie mystificatrice de l’universalisme abstrait et pour l’accès universel aux conditions d’accès à l’universel » (Méditations pascaliennes, chapitre 2, « Les trois formes de l’erreur scolastique », sous-chapitre intitulé « Le moralisme comme universalisme égoïste, p. 104).
Ce qui, d’après Bourdieu, rend possible l’accès à l’universel, c’est ce qu’il appelle l’état « scolastique », ou la skholè, suffisamment délivrée des urgences pratiques, dont bénéficiaient déjà les philosophes de l’antiquité gréco-latine. Ce temps libéré des occupations et des préoccupations pratiques, dont l’école… aménage une forme privilégiée, le loisir studieux, est la condition de l’exercice scolaire et des activités arrachées à la nécessité immédiate, comme le sport, le jeu, la production et la contemplation des œuvres d’art et toutes les formes de spéculation gratuite, sans autre fin qu’elles-mêmes » (Méditations pascaliennes, chapitre 1, « Critique de la raison scolastique », sous-chapitre intitulé « L’ambiguïté de la disposition scolastique », p. 28).
« L’ambiguïté fondamentale des univers scolastiques et de leurs productions repose sur le fait que la coupure avec le monde de la production est à la fois rupture libératrice et séparation, déconnection, qui enferme la virtualité d’une mutilation: si la mise en suspens de la nécessité économique et sociale est ce qui autorise l’émergence de champs autonomes, elle est aussi ce qui menace d’enfermer la pensée scolastique dans les limites ou présupposés ignorés ou refoulés, qu’implique le retrait hors du monde » (Méditations pascaliennes, « L’ambiguïté de la disposition scolastique », sous-chapitre du chapitre 1 « Critique de la raison scolastique », p. 30-31).
« Nombre de professions de foi universalistes ou de prescriptions universelles ne sont que le produit de l’universalisation (inconsciente) du cas particulier, c’est-à-dire du privilège constitutif de la condition scolastique. Cette universalisation purement théorique conduit à un universalisme fictif aussi longtemps qu’elle ne s’accompagne d’aucun rappel des conditions économiques et sociales refoulées de l’accès à l’universel et d’aucune action (politique) visant à universaliser pratiquement ces conditions. Accorder à tous, mais de manière purement formelle, l’humanité, c’est en
exclure, sous les dehors de l’humanisme, tous ceux qui sont dépossédés desmoyens la réaliser » (Méditations pascaliennes, chapitre 2 : « Les trois formes de l’erreur scolastique », fondements historiques de la raison », sous-chapitre intitulé : «L’universalité des stratégies d’universalisation », p. 97).
Bourdieu pense d’abord à « l’institution scolaire, dans la mesure où elle est capable d’imposer la reconnaissance à peu près universelle de la loi culturelle tout en étant très loin d’être capable de distribuer de manière aussi large la connaissance des acquis qui lui est nécessaire pour lui obéir…» (Méditations pascaliennes, chapitre 2 : « Les trois formes de l’erreur scolastique », fondements historiques de la raison », sous-chapitre intitulé : « L’universalité des stratégies d’universalisation », p. 103-105).
« Il faudra sans doute mobiliser toujours plus de ressources et de justifications techniques et rationnelles pour dominer, et les dominés devront se servir toujours davantage de la raison pour se défendre contre des formes de plus en plus rationalisées de domination (je pense par exemple à l’usage politique des sondages comme instruments de démagogie rationnelle). Les sciences sociales… devront plus clairement que jamais choisir entre deux partis : mettre leurs instruments rationnels de connaissance au service d’une domination toujours plus rationalisée, ou analyser rationnellement la domination… La conscience et la connaissance des conditions sociales de cette sorte de scandale logique et politique qu’est la monopolisation de l’universel indiquent sans équivoque les fins et les moyens d’une lutte politique permanente pour l’universalisation des conditions d’accès à l’universel » (Méditations pascaliennes, chapitre 3, « Les trois formes de l’erreur scolastique », sous-chapitre intitulé « La forme suprême de la violence symbolique », p. 121).
La raison n’étant pas enracinée dans une nature anhistorique, « on peut s’armer d’une science historique des conditions historiques de son émergence pour tenter de renforcer tout ce qui, dans chacun des différents champs, est de nature à favoriser le règne sans partage de sa logique spécifique, c’est-à-dire l’indépendance à l’égard de toute espèce de pouvoir ou d’autorité extrinsèque – tradition, religion, Etat, forces du marché. On pourrait ainsi, dans cet esprit, traiter la description réaliste du champ scientifique comme une sorte d’utopie raisonnable de ce que pourrait être un champ politique conforme à la raison démocratique…
…Dès que des principes prétendant à la validité universelle (ceux de la démocratie par exemple) sont énoncés et officiellement professés, il n’est plus de situation sociale où ils ne puissent servir au moins comme des armes symboliques dans les luttes d’intérêt ou comme des instruments de critique pour ceux qui ont intérêt à la vérité ou à la vertu (comme aujourd’hui tous ceux qui, notamment dans la petite noblesse d’Etat, ont partie liée avec les acquis universels associées à l’Etat et au droit) ». Ce qui est dit là s’applique en priorité à l’Etat qui, comme tous les acquis liés à l’histoire des champs scolastiques, est marqué d’une profonde ambiguïté (ambiguïté toutefois moins défavorable à ce qu’on peut appeler la justice, que ce qui est exalté, sous les couleurs de la liberté et du libéralisme, par les partisans du « laisser-faire » économique (Méditations pascaliennes, chapitre 3 : « les fondements historiques de la raison », sous-chapitre intitulé : « L’universalité des stratégies d’universalisation », p. 182-184).
BOURDIEU ET PASCAL
« J’avais pris l’habitude, depuis longtemps, écrit le sociologue, lorsqu’on me posait la question, généralement mal intentionnée, de mes rapports avec Marx, de répondre qu’à tout prendre, et s’il fallait à tout prix s’affilier, je me dirais plutôt pascalien » (Méditations pascaliennes, introduction, p.10)
Blaise Pascal, inventeur du calcul des probabilités, a été implicitement présent dans l’œuvre de Bourdieu depuis le commencement, par exemple dans les réflexions du sociologue sur les probabilités ou chances d’accès à l’université. Sa présence philosophique s’est affirmée à partir de la Leçon sur la leçon (1982), dont la fin fait entendre des accents typiquement pascaliens. Elle a atteint son apogée dans les Méditations pascaliennes de 1997.
Bourdieu s’est référé aux Pensées de Pascal pour traiter de nombreux sujets : les probabilités, les trois sortes de « libido », les ordres pascaliens et les champs sociaux, les « demi-habiles », le sens de l’existence et la question de Dieu.
Les citations de Pascal sont tirées des Pensées, éd. Brunschvicg, Paris, Hachette, 1912, en abrégé Br.
Les probabilités
Dans Les Héritiers, il est longuement question des « chances » d’accès à l’enseignement supérieur en fonction de l’origine sociale. Le thème « probabilités objectives et espérances subjectives » de La Reproduction est repris dans les Méditations pascaliennes (chapitre 6, sous-chapitres intitulés « La relation entre les espérances et les chances » et « Retour à la relation entre les espérances et les chances »).
« Pour que s’instaure cette relation particulière entre les espérances subjectives et les chances objectives qui définit l’investissement, l’intérêt, l’illusio, il faut … que l’agent dispose de chances de gagner qui ne soient ni nulles (à tous les coups l’on perd) ni totales (à tous les coups l’on gagne), ou, autrement dit, que rien ne soit absolument sûr sans que tout soit possible pour autant. Il faut qu’il y ait dans le jeu une partd’indétermination, de contingence, de « jeu », mais aussi une certaine nécessité dans la contingence, donc la possibilité d’une connaissance, d’une forme d’anticipation raisonnable, celle qu’assure la coutume ou, à défaut, la « règle des partis », que Pascal tentera d’élaborer, et qui permet, comme il dit, de « travailler pour l’incertain ». Bourdieu évoque une « loi tendancielle des conduites humaines, qui fait que l’espérance subjective de profit tend à se proportionner à la probabilité objective de profit, commande la propension à investir (de l’argent, du travail, du temps, de l’affectivité, etc.) dans les différents champs » (Méditations pascaliennes, chapitre 6, « L’être social, le temps et le sens de l’existence », sous-chapitre intitulé « L’ordre des successions », p. 308-312)
Les trois sortes de « libido »
Le sociologue a emprunté à Pascal les trois sortes de « libido » (désir des sens, désir de savoir, désir de dominer). Pascal lui-même les a empruntées à saint Augustin.
Pour Pascal, « tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie : libido sentiendi, libido sciendi, libido dominandi » (Pensées, 458). Et : « Il y a trois ordres de choses : la chair, l’esprit, la volonté. Les charnels sont les riches, les rois ; ils ont pour objet le corps. Les curieux et savants : ils ont pour objet l’esprit. Les sages : ils ont pour objet la justice » (Pensées, 460).
« Les philosophies de la sagesse, écrit Bourdieu, tendent à réduire toutes les espèces d’illusio, même les plus « pures », comme la libido sciendi, à de simples illusions, dont il faut s’affranchir pour accéder à la liberté spirituelle à l’égard de tous les enjeux mondains… C’est aussi ce que fait Pascal lorsqu’il condamne comme « divertissement » les formes de « concupiscence » associées aux ordres inférieurs, de la chair ou de l’esprit, parce qu’elles ont pour effet de détourner de la seule croyance véritable, celle qui s’engendre dans l’ordre de la charité » (Méditations pascaliennes, chapitre 3, « Les Fondements historiques de la raison », sous-chapitre intitulé « Des points de vue institués », p.146-147).
Bourdieu souhaite sauver des condamnations pascaliennes le désir de savoir, qui peut être une forme sublimée du désir de dominer (voir le chapitre 2 du présent ouvrage):
« L’affrontement anarchique des investissements et des intérêts individuels ne se transforme en dialogue rationnel que dans la mesure et dans la mesure seulement où le champ est assez autonome … pour exclure l’importation d’armes non spécifiques, politiques et économiques notamment, dans les luttes internes ; dans la mesure où les participants sont contraints à ne recourir qu’à des instruments de discussion ou de preuve conformes aux exigences scientifiques en la matière…, donc obligés de sublimer leur libido dominandi en une libido sciendi qui ne peut triompher qu’en opposant une réfutation à une démonstration, un fait scientifique à un autre fait scientifique » (Méditations pascaliennes, chapitre 3, « Les fondements historiques de la
raison », sous-chapitre intitulé « Censure du champ et sublimation scientifique », p. 161).
Les ordres de Pascal et les champs sociaux de Bourdieu
Reprenant avec quelques modifications ce que dit à ce sujet la fin de la Leçon sur la leçon (p. 47), les Méditations pascaliennes (chapitre 3, « Les Fondements historiques de la raison », sous-chapitre intitulé « Le nomos et l’illusio », p.140-141) réaffirment l’idée que chaque champ, « comme l’ordre pascalien », enferme les agents dans ses enjeux propres : « par exemple, écrit Bourdieu, les ambitions de carrière du haut fonctionnaire peuvent laisser le chercheur indifférent, et les investissements à fonds perdus de l’artiste ou la lutte des journalistes pour l’accès à la « une » restent à peu près inintelligibles pour le banquier… et aussi, sans doute, pour toutes les personnes étrangères au champ, c’est-à-dire, bien souvent, pour les observateurs superficiels ».
Ce texte est précédé par la pensée Br 793 de Pascal que cite Bourdieu pour insister sur l’autonomie des différents champs les uns par rapport aux autres :
« Tout l’éclat des grandeurs n’a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l’esprit.
La grandeur des gens d’esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces gens de chair.
La grandeur de la sagesse … est invisible aux charnels et aux gens d’esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. »
Le corps dans le monde et le monde dans le corps
Bourdieu, pour qui « le corps est dans le monde social, mais le monde social est dans le corps » (Leçon sur la leçon, p. 38), se réfère à « une très belle formule pascalienne, qui conduit d’emblée au-delà de l’alternative de l’objectivisme et du subjectivisme : « … par l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends. » (Pensées, Br 348). « On aura compris, précise-t-il, que j’ai tacitement élargi la notion d’espace pour y faire entrer, à côté de l’espace physique, auquel pense Pascal, l’espace social… Le « je » qui comprend pratiquement l’espace physique et l’espace social (sujet du verbe comprendre, il n’est pas nécessairement un « sujet » au sens des philosophies de la conscience, mais plutôt un habitus, un système de dispositions) est compris, en un tout autre sens, c’est-à-dire englobé, inscrit, impliqué dans cet espace…
De cette relation de double inclusion se laissent déduire tous les paradoxes que Pascal rassemblait sous le chapitre de la misère et de la grandeur, et que devraient méditer tous ceux qui restent enfermés dans l’alternative scolaire du déterminisme et de la liberté : déterminé (misère), l’homme peut connaître ses déterminations (grandeur) et travailler à les surmonter. Paradoxes qui trouvent tous leur principe dans le privilège de la réflexivité : « … l’homme connaît qu’il est misérable …; mais il est bien grand, puisqu’il le connaît »… Et peut-être, selon la même dialectique, typiquement pascalienne, du renversement du pour au contre, « la sociologie, forme de pensée honnie des « penseurs » parce qu’elle donne accès à la connaissance des déterminations sociales qui pèsent sur eux, donc sur leur pensée, est-elle en mesure de leur offrir, mieux que les ruptures d’apparence radicale qui, bien souvent, laissent les choses inchangées, la possibilité de s’arracher à une des formes les plus communes de
la misère et de la faiblesse auxquelles l’ignorance ou le refus hautain de savoir condamnent si souvent la pensée » (Méditations pascaliennes, chapitre 4, « La Connaissance par corps », sous-chapitre intitulé « Analysis situs », p. 189-191).
Les « demi-habiles »
Selon Bourdieu, « la naïveté du premier ordre, qui consiste à accepter la représentation idéale ou idéalisée que donnent d’eux-mêmes les pouvoirs symboliques (Etat, Droit, Art, Science, etc.), appelle en quelque sorte une naïveté du second ordre, celle des « demi-habiles », comme aurait dit Pascal, qui ne veulent pas s’en laisser conter. Le plaisir de se sentir malin, démystifié et démystificateur, de jouer les désenchantés désenchanteurs, est au principe de beaucoup d’erreurs scientifiques : ne fût-ce que parce qu’il porte à oublier que l’illusion dénoncée fait partie de la réalité et qu’elle doit être inscrite dans le modèle qui doit en rendre raison …» (Raisons pratiques, chapitre 7 « Pour une science des œuvres », annexe 2, p. 93).
Face à l’étonnement de Hume qui s’interroge sur la facilité avec laquelle les dominants imposent leur domination, Bourdieu évoque Pascal (Pensées, Br 324 et Br 327) : le peuple a les opinions très saines… Les demi-savants s’en moquent, et triomphent à montrer là-dessus la folie du monde ; mais, par une raison qu’ils ne pénètrent pas, on a raison ». Et la vraie philosophie se moque de la philosophie de « ceux d’entre deux », qui « font les entendus » en se moquant du peuple, sous prétexte qu’il ne s’étonne pas assez de tant de choses si dignes d’étonnement…
Pour Bourdieu, « on peut lire comme un programme de travail scientifique et politique » les textes fameux de Pascal sur sa dialectique en spirale (Pensées, Br 328-337): « Renversement continuel du pour au contre. Nous avons donc montré que l’homme est vain, par l’estime qu’il fait des choses qui ne sont point essentielles ; et toutes ces opinions sont détruites. Nous avons montré ensuite que toutes ces opinions sont très saines, et qu’ainsi toutes ces vanités étant très bien fondées… le peuple n’est pas si vain qu’on dit ; et ainsi nous avons détruit l’opinion qui détruisait celle du peuple. Mais il faut détruire maintenant cette dernière proposition, et montrer qu’il demeure toujours vrai que le peuple est vain, quoique ses opinions soient saines ; parce qu’il n’en sent pas la vérité où elle est, et que, la mettant où elle n’est pas, ses opinions sont toujours très fausses et très mal saines » (Méditations pascaliennes, chapitre 5, « Violence symbolique et luttes politiques », sous-chapitre intitulé « Le pouvoir symbolique », p.257-259).
« Le « demi-habile », commente le sociologue, tout à son plaisir de démystifier et de dénoncer, ignore que ceux qu’il croit détromper, ou démasquer, connaissent et refusent à la fois la vérité qu’il prétend leur révéler. Il ne peut comprendre, et prendre en compte, les jeux de la self deception, qui permettent de perpétuer l’illusion sur soi, et de sauvegarder une forme tolérable, ou vivable, de « vérité subjective » contre les rappels aux réalités et au réalisme, et souvent avec la complicité de l’institution » (Méditations pascaliennes, chapitre 5, « Violence symbolique et luttes politiques », sous-chapitre intitulé « La double vérité », p. 273).
Le sens de l’existence et la question de Dieu
« A travers les jeux sociaux qu’il propose, le monde social procure aux agents bien plus et autre chose que les enjeux apparents, les fins manifestes de l’action : la chasse compte autant, sinon plus, que la prise et il y a un profit de l’action qui excède les profits explicitement poursuivis, salaire, prix, récompense, trophée, titre, fonction, et qui consiste dans le fait de sortir de l’indifférence, et de s’affirmer comme agent agissant, pris au jeu, occupé, habitant du monde habité par le monde, projeté vers des fins et doté, objectivement, donc subjectivement, d’une mission sociale… Misère de l’homme sans Dieu, disait Pascal. Misère de l’homme sans mission ni consécration sociale » (Leçon sur la leçon, p. 47-52. Voir aussi, avec quelques modifications de texte, les Méditations pascaliennes, chapitre 3, « Les Fondements historiques de la raison », sous-chapitre intitulé « Le nomos et l’illusio », p.140-141).
Ce passage est explicitement inspiré de Pascal (Pensées Br 139) qui réfléchit à la raison pour laquelle on aime mieux la chasse que la prise : « Ce lièvre ne nous garantit pas de la vue de la mort et des misères, mais la chasse – qui nous en détourne – nous en garantit »).
« Avec l’investissement dans un jeu et la reconnaissance que peut apporter la compétition coopérative avec les autres, le monde social offre aux humains ce dont ils sont le plus totalement dépourvus : une justification d’exister ». Il faut, ajoute Bourdieu, « prendre acte d’une donnée anthropologique que les habitudes de pensée conduisent à rejeter dans l’ordre de la métaphysique, à savoir la contingence de l’existence humaine, et surtout sa finitude, dont Pascal observe que, bien qu’elle soit la seule chose certaine dans la vie, nous mettons tout en œuvre pour l’oublier, en nous jetant dans le divertissement, ou en nous réfugiant dans « la société » … » (Méditations pascaliennes, chapitre 6, « L’être social, le temps et le sens de l’existence », sous-chapitre intitulé « La question de la justification », p.343, et Pascal, Pensées, Br, 211).
Bourdieu termine à la fois sa Leçon sur la leçon et ses Méditations pascaliennes par ce genre de questions qui le fait passer de l’anthropologie à ce que l’on classe dans la métaphysique :
« La sociologie ne peut comprendre le jeu social dans ce qu’il a de plus essentiel qu’à condition de prendre en compte certaines des caractéristiques universelles de l’existence corporelle, comme le fait d’exister à l’état d’individu biologique séparé, ou d’être cantonné dans un lieu et un moment, ou encore le fait d’être et de se savoir destiné à la mort… Voué à la mort, cette fin qui ne peut être prise pour fin, l’homme est un être sans raison d’être. C’est la société, et elle seule, qui dispense, à des degrés différents, les justifications et les raisons d’exister… Misère de l’homme sans Dieu, disait Pascal. Misère de l’homme sans mission ni consécration sociale. En effet, sans aller jusqu’à dire, avec Durkheim, « la société, c’est Dieu », je dirais : Dieu, ce n’est jamais que la société » (Leçon sur la leçon, p. 50-52).
Bourdieu évoque encore, à la dernière page de ses Méditations pascaliennes, « cette sorte de réalisation de Dieu sur la terre qu’est l’Etat qui garantit, en dernier ressort, la série infinie des actes d’autorité certifiant par délégation la validité des certificats d’existence légitime (comme malade, invalide, agrégé ou curé). Et la sociologie s’achève ainsi dans une sorte de théologie de la dernière instance : investi, comme le tribunal de Kafka, d’un pouvoir absolu de véridiction et d’une perception créatrice, l’Etat,
pareil à l’intuitus originarius divin selon Kant, fait exister en nommant, et en distinguant. Durkheim, on le voit, n’était pas aussi naïf qu’on veut le faire croire lorsqu’il disait, comme aurait pu le faire Kafka, que « la société, c’est Dieu ».
***
ANNEXE
Les doubles vérités sociologiques de Bourdieu
Bourdieu s’est présenté lui-même comme un homme à l’habitus « clivé », et il a manifesté une prédilection pour l’analyse des situations où apparaît une « double vérité », par exemple dans le cas des institutions religieuses (à la fois économiques et non économiques) ou dans le cas de l’Etat, présenté par lui comme une réalité à double face, à la fois monopolisation impérialiste et progrès.
Pour se rappeler de quoi il est question quand Bourdieu parle de doubles vérités, qu’il dénomme aussi ambiguïtés, il est utile de parcourir la table des matières de Méditations pascaliennes. On y trouve plusieurs passages éclairants.
Ainsi, le chapitre premier de ce livre comporte un sous-chapitre intitulé: « L’Ambiguïté de la disposition scolastique ». Cette situation – dont l’ordre scolaire représente la forme institutionnalisée – repose sur le fait que la coupure scolastique avec le monde de la production est à la fois rupture libératrice et déconnection qui enferme la virtualité d’une mutilation; si la mise en suspens de la nécessité économique et sociale est ce qui autorise l’émergence de champs autonomes ne connaissant et ne reconnaissant que la loi qui leur est propre, elle est aussi ce qui menace d’enfermer la pensée scolastique dans les présupposés ignorés ou refoulés qu’implique le retrait hors du monde.
Dans le chapitre 2 et son sous-chapitre intitulé : « L’Ambiguïté de la raison », Bourdieu explique que le rappel des conditions sociales ayant fait émerger des univers où s’engendre l’universel interdit de sacrifier à l’optimisme naïvement universaliste des « Lumières » : l’avènement de la raison est inséparable de l’autonomisation de microcosmes sociaux fondés sur le privilège, où se sont peu à peu inventés des modes de pensée et d’action théoriquement universels mais pratiquement monopolisés par quelques-uns.
Dans le chapitre 3, le sous-chapitre intitulé : « Le Double visage de la raison scientifique » explique que les champs scientifiques, sous un certain rapport, sont des mondes sociaux comme les autres, avec des concentrations de pouvoir et de capital, des monopoles, des rapports de force, des intérêts égoïstes, des conflits, mais qu’ils sont aussi, sous un autre rapport, des univers d’exception, un peu miraculeux, où la nécessité de la raison se trouve instituée dans la réalité des structures et des dispositions. Fondés sur la distance scolastique à l’égard de la nécessité et de l’urgence économiques, ils favorisent des échanges sociaux dans lesquels les contraintes sociales prennent la forme de contraintes logiques. S’ils sont favorables au développement de la raison, c’est que, pour s’y faire valoir, il faut faire valoir des raisons ; pour y triompher, il faut faire triompher des arguments, des démonstrations ou des réfutations.
Le chapitre 5 comporte deux sous-chapitres intitulés respectivement : « La Double naturalisation et ses effets » et « La Double vérité », avec deux « études de cas : « La Double vérité du don » et « La Double vérité du travail ». L’un des mécanismes les plus puissants assurant le maintien de l’ordre symbolique est la « double naturalisation » qui résulte de l’inscription du social à la fois dans les choses et dans les têtes (« dans les corps », dit Bourdieu), aussi bien chez les dominants que chez les dominés, avec des effets de violence symbolique (contrainte exercée avec l’assentiment des dominés).