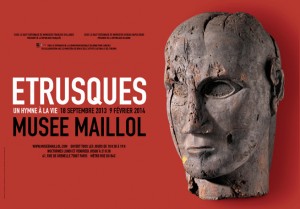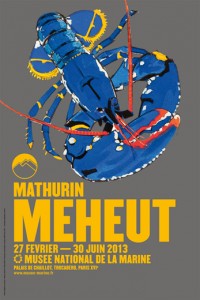La Sainte Anne, l’ultime chef-d’œuvre de Léonard de Vinci, Musée du Louvre, exposition de 2012

On peut admirer au Louvre la magnifique restauration du tableau de Léonard de Vinci (Vinci 1452-Amboise 1519), Sainte Anne, (168 cm x 130 cm), peint à partir de 1503 sur un panneau de bois de peuplier. Cette restauration menée pendant quatre années par Cinzia Pasquali redonne à l’oeuvre son extrême beauté, dont on ne sait si elle est due à la grâce des personnages, à l’éclat des couleurs, en particulier dans ses drapés lapis lazuli, rouge kermès, gris perle, ou bien encore aux vibrations de la lumière.
Il semble – en tout cas ce sera l’hypothèse que je développerai – que le tableau est inspiré moins par la religion que par l’expérience personnelle du peintre, son propre rapport à la peinture. C’est une sorte d’image de rêve, avec ses déplacements, ses dédoublements, ses condensations, image onirique dans laquelle Léonard s’identifie à l’enfant Jésus, prêt à se saisir de l’agneau représentant son destin, sous le regard maternel de deux jeunes femmes au sourire de Joconde.
La visite nous entraîne à travers quatre époques de la vie de Léonard, sur les lieux qui l’ont vu, pendant plus de quinze ans, de 1502/1503 à 1518, commencer et parfaire, sans toutefois l’achever, ce tableau. L’intérêt et l’enjeu des quelque deux cents esquisses, copies, tableaux et documents d’archives exposés, dont certains sont à eux seuls des trésors, se comprennent d’autant mieux qu’on les réfère aux trois cartons préparatoires dessinés dans les années 1500/ 1503.
La Sainte Anne, dite Trinitaire : un même sujet religieux et politique, renouvelé sous quatre « mécénats » différents
Pourquoi « Trinitaire » ? Ce qualificatif, employé dans l’exposition, introduit une confusion, peut-être voulue, avec le dogme théologique de la trinité de Dieu. C’est pourquoi certains lui préfèrent l’allemand Selbdritt, l’italien Metterza ou bien la locution « en tierce ». Dans la tradition, Sainte Anne est en effet représentée tenant dans les bras Marie et Jésus, tous deux également enfants ; parfois Marie est une adulte en miniature. Ce thème de la confusion des générations se retrouve dans le tableau de Vinci. Dans d’autres représentations, que l’on voit aussi dès l’entrée de l’exposition, la Vierge est assise sur les genoux de sainte Anne et Jésus sur les genoux de sa mère.
En ce début de XVI° siècle et depuis le moyen-âge, le culte de sainte Anne, mère de Marie et grand-mère de Jésus, fait l’objet d’une grande ferveur ; ce sera une cible privilégiée des attaques de Luther. C’est une époque où l’on soutient des discussions passionnées sur l’Immaculée Conception de Marie (Marie conçue sans péché originel) et sur la virginité de la mère de Jésus. Après la Contre-Réforme, le sujet de sainte Anne trinitaire est plus ou moins délaissé au profit du groupe de Joseph, Marie et Jésus.
Léonard de Vinci commence son tableau dans la jeune république de Florence où il arrive, venant de Milan, en 1500. En 1507, rappelé par le roi de France Louis XII, alors duc de Milan, Léonard retourne dans cette ville. Il y reste jusqu’au moment où les Français en sont chassés, en 1512 et se rend en 1513 à Rome, auprès du frère de Léon X, Julien de Médicis, qui meurt en 1516. En 1516, il traverse les Alpes à dos de mulet pour rejoindre la cour de François Ier et passe la fin de sa vie en France au château de Clos Lucé, près de Chambord. Il meurt en 1519.
Qui est le commanditaire du tableau ? La question reste confuse ; peut-être est-ce finalement le peintre lui-même, même s’il l’a destiné à différents mécènes, comme le montre ce bref historique de ses lieux de séjour, qu’évoquent certains tableaux.
Florence : Depuis le 26 juillet 1343 (jour de la fête de sainte Anne), où le peuple florentin a chassé le tyran Gautier de Brienne, sainte Anne est la patronne de la ville. C’est aussi la patronne qu’adopte la toute jeune république créée après le départ des Médicis en 1494. Il n’est pas impossible que Léonard, voulant célébrer son arrivée à Florence, grand centre de la peinture, ait pris lui-même l’initiative du sujet pour son tableau. Ce serait un choix républicain.
Milan est depuis 1499 entre les mains du roi de France Louis XII, qui a épousé Anne de Bretagne. Il n’est pas impossible non plus que le roi ait fait à Léonard cette commande pour honorer la sainte patronne que vénérait sa nouvelle épouse : Anne de Bretagne, comme Anne d’Autriche plus tard, favorisèrent le culte de la sainte. Ce qui est sûr, c’est que dès 1505, Léonard voulait envoyer le tableau à Louis XII.
Rome : Le sujet religieux, qui met en scène l’incarnation de Dieu sur terre, la filiation maternelle, immaculée et virginale, du Christ ainsi que son destin, ont pleinement leur place dans la ville papale à cette époque de grande dévotion aux saints. D’autre part, Julien de Médicis, frère du pape et protecteur de Léonard à Rome, lui aurait passé commande d’un portrait de sa maîtresse, réel modèle de La Joconde, dont le sourire aurait redonné à Léonard de Vinci le goût de peindre.
La France : Léonard de Vinci emporte avec lui en France seulement trois tableaux : le portrait de La Joconde ; celui de Saint Jean-Baptiste, au sourire de Joconde; la Sainte Anne, tableau inachevé, sur lequel le sourire de Mona Lisa se dédouble pour animer à la fois le visage de Sainte Anne et celui de Marie. Le fameux sourire est donc un trait commun aux trois œuvres. On a des témoignages de la dévolution ou attribution de la Sainte Anne au roi François Ier en 1518.
Exposé peut-être au château d’Amboise puis dans une chapelle, le tableau ne réapparaît qu’en 1651, à Paris dans le Palais Royal. En 1797, il est accroché dans le salon carré du Louvre.
Il semble que le tableau soit inspiré moins par la religion ou l’histoire que par l’expérience du peintre lui-même, son propre rapport à la peinture. C’est une sorte d’image de rêve, d’image onirique dans laquelle Léonard s’identifie à l’enfant Jésus, prêt à se saisir de l’agneau représentant son destin, sous le regard maternel de deux jeunes femmes au sourire apaisé.
Les trois cartons
La simple étude des étapes successives que constituent les trois cartons préparatoires au tableau est éclairante à cet égard. Ces trois cartons, ont été dessinés de 1500 à 1503, à l’époque du séjour à Florence. Ils ont été copiés de façon plus ou moins heureuse, comme on le voit dans les premières salles.
L’exposition ne présente que le premier carton, dit de Burlington, prêté par la National Gallery. Il est accroché comme pendant du tableau lui-même. Fait d’un assemblage de huit feuilles de papier collées, à l’échelle de la peinture envisagée (141,5 x 104,6), il est assez proche du « brouillon » qu’est le componimento inculto, composition instinctive de départ, indispensable à toute création selon Vinci, présenté lui-aussi sur les murs de l’exposition.
Un groupe de quatre personnages est inscrit dans une sorte de pyramide, où l’on distingue deux femmes assez semblables par l’âge et la taille, sur la même ligne horizontale. Anne de son doigt levé vers le ciel semble désigner les desseins de Dieu. Les deux cousins enfants sont face à face, Jésus bénissant Jean-Baptiste (Saint Jean-Baptiste dans la bible annonce la venue du Christ ; il est représenté vêtu d’une peau de mouton). Ce carton daterait d’avant 1501, peut-être de 1500.
Le second carton, d’avril 1501, est perdu et, à la différence du troisième, également perdu, il a été peu recopié. Deux feuilles conservées au Louvre et à Venise, de Léonard lui-même, un tableau des frères Brescianino de 1515/1517, un autre de 1507 de Raphaël (qui a ajouté saint Joseph) nous permettent toutefois de l’imaginer. Le rythme est vertical : sur la diagonale descendant vers la gauche se lit la succession des trois générations. Anne est plus âgée que Marie. Jean-Baptiste a disparu, remplacé par l’agneau du sacrifice.
Le troisième carton, de 1503, a disparu à Budapest, pendant la seconde Guerre Mondiale. La réflectographie infrarouge du tableau du Louvre en donne toutefois une idée précise. La diagonale des trois générations descend cette fois vers la droite, Marie s’est penchée vers l’enfant dans un mouvement fait pour le retenir ou du moins accompagner son action. Anne, redevenue presque aussi jeune que Marie, contemple la scène, les yeux baissés.
Lecture du tableau à partir de la comparaison entre les trois cartons : une image rêvée de l’art de Vinci
Le tableau est fascinant par les lectures multiples qu’il suscite, notamment grâce à l’identification possible de Léonard au personnage de l’enfant. C’est vers lui que convergent les regards d’Anne, de Marie et de l’agneau. La lumière, venant de droite, met en valeur l’échange des regards et des sourires ainsi que la continuité des gestes (même épaule pour Anne et Marie, même orientation des bras pour Marie et l’enfant, qui est entre les jambes de sa mère). L’enfant est la cause du mouvement qui anime toute la scène.
Les lectures religieuse et politique du tableau seraient intéressantes à développer. La lecture religieuse donne évidemment les éléments de base de l’interprétation. Elle est orientée, on l’a vu, par les questions de l’incarnation de Dieu sur terre, de sa filiation humaine, la filiation maternelle, et enfin par celle du destin de Jésus (passion et résurrection), représenté par l’agneau.
Incarnation, filiation maternelle, destin exceptionnel, nous reprendrons ces thèmes. Mais nous en déplacerons l’enjeu, en mettant l’accent sur une lecture plus en rapport avec le peintre lui-même et son art. Nous accepterons l’idée que Léonard s’identifie à l’enfant, comme Freud le propose dans son « roman psychanalytique » Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci. (Lui-même, le découvreur du monde intérieur, n’a pas manqué de s’identifier à Léonard, découvreur du monde extérieur).
L’artiste se représente dans une humanissima trinitas, féminine, maternelle et naturelle. Léonard de Vinci associe son art, son destin à la filiation maternelle, elle-même confondue avec la nature. La peinture apparaît alors comme une incarnation des leçons de la nature, qui prennent vie.
La peinture dans sa relation avec la filiation maternelle
Comme on l’a vu, le deuxième carton concentre le sujet du tableau sur l’action de l’enfant Jésus : alors qu’il était assis sur les genoux de sa mère sur le carton de Burlington, il est descendu à terre pour ne pas dire sur terre et s’apprête à monter sur l’agneau.
Le thème du double, très présent dans le carton de Burlington – Anne double de Marie ; Jean-Baptiste double de Jésus – disparaît au profit d’une présentation ordonnée des générations et de l’annonce du sacrifice de Jésus, représenté par l’agneau.
Il semble que les reconstructions biographiques de Freud concernant l’abandon de Léonard par son père soient contestables. Cependant sa référence aux deux mères de Léonard est difficile à écarter. Comment ne pas penser, en voyant les deux femmes, à la mère naturelle de Léonard, Catarina, jeune servante abandonnée par son père, et d’autre part à la jeune épouse stérile de ce dernier, Donna Albiera, qui prit soin de l’enfant au foyer paternel ? Sur le carton de Burlington, les deux personnages féminins ont même sourire, même âge, une certaine confusion se lit dans le dessin des corps.
Sur les dessins associés au second carton, Anne est nettement plus âgée que sa fille. Pourquoi ne pas faire avec Freud l’hypothèse que sainte Anne, l’ancêtre, la femme la plus éloignée spatialement, représente Catarina, l’image originelle – celle du fameux sourire -, qui dans son amour pour l’enfant a consenti à son adoption par la femme légitime de son père. L’expression contemplative et retenue exprimerait la magnanimité de cet amour maternel (ou cacherait son envie, comme le dit Freud). Sainte Anne est représentée dans une position proche de celle de la Léda, humaine séduite par Zeus ayant pris la forme d’un cygne, que Léonard peint au même moment (elle est accrochée sur les murs de l’exposition). On peut penser aussi que sainte Anne figure la grand-mère paternelle très aimée, Mona Lucia. Déplacements, dédoublements et condensations sont monnaie courante dans les rêves ou les tableaux oniriques et il semble bien que ce tableau soit une image de rêve.
Marie présente l’expression d’une grande tendresse. Sa robe bleue touche les lèvres de l’enfant, comme l’aurait fait le vautour du fameux rêve de Léonard : “Il semble que j’aie depuis toujours été destiné à m’occuper du vol des oiseaux. Dans mon plus ancien souvenir d’enfance, il me semble qu’un vautour a volé jusqu’à moi, m’a ouvert la bouche de sa queue et l’a plusieurs fois battue de ci de là entre mes lèvres” (Codex sur le vol des oiseaux).
Dans son étude du rêve, Freud, qui a lu le texte dans sa traduction allemande, met en relation le vautour, dont le hiéroglyphe égyptien signifie aussi mère, avec la séduction maternelle. Mais en fait le texte italien parle non de vautour mais de milan. Et pourtant l’intuition de Freud là non plus n’est pas à écarter : sur le tableau, l’enfant semble se rebiffer contre cette mère trop tendre, séduisante sinon séductrice. En tout cas, la représentation picturale est à elle seule une distance prise par rapport à la séduction maternelle, si évidente dans ce tableau.
Peut-être aussi l’abandon du thème des jeunes cousins nous dit-il quelque chose de la sublimation par l’art qui a été le choix de Vinci, au détriment de ses satisfactions sensuelles. Ce serait une façon de parler de son homosexualité, puisqu’on sait que le peintre a vécu avec de jeunes amis.
La filiation maternelle et la nature
Dans le second carton, le doigt levé vers le ciel de sainte Anne a disparu, ainsi que le geste de bénédiction de Jésus. Comme si le peintre écartait dans le tableau la transcendance divine et l’autorité paternelle.
Pourtant le père de Léonard est bien présent, ne serait-ce que de façon négative, nous dit Freud. Selon lui, le non finito serait un trait d’identification de Léonard à son père. De même que Ser Piero da Vinci a laissé inachevée la tâche paternelle en abandonnant Catarina, de même Léonard abandonnait ses tableaux sans les finir. C’est le cas de La Sainte Anne, dont la partie intermédiaire du fond, entre montagnes et premier plan, est inachevée, tout comme la robe d’Anne elle-même.
Non seulement Léonard n’a pas été abandonné par Ser Piero mais il n’a jamais renié les leçons de son maître Verrochio. S’il n’imite aucun modèle, s’il ne veut regarder aucun maître mais seulement la nature et lui dérober ses secrets, c’est qu’il a déplacé sur elle son intérêt pour la mère « naturelle » : Il osa émettre cette affirmation hardie qui n’en contient pas moins la justification de toute recherche libre : « Qui dans le conflit des opinions se réfère à l’autorité opère avec sa mémoire au lieu d’opérer avec son entendement ». (…) Retransposés de l’abstraction scientifique à l’expérience concrète individuelle, les Anciens et l’autorité ne correspondaient finalement qu’au père, et la nature redevenait la bonne et tendre mère qui l’avait nourri (Un souvenir d’enfance, folio, 2002, p.231, 233.)
La nature redevenait la bonne et tendre mère qui l’avait nourri. Le troisième carton en témoigne. Il garde la composition verticale mais Anne, comme dans le premier carton, est une jeune femme. La mère naturelle, comme on dit « enfant naturel », et la mère légitime sont comme sœurs par l’âge, la grâce, la tendresse et la foi. Le fait de retourner la diagonale descendante vers la droite tourne vers la vie le destin de l’enfant.
La peinture, incarnation des leçons de la nature
Neiges éternelles sur les sommets, terres stériles sur lesquelles se dresse un arbre de vie, le panorama est grandiose : une immense chaîne de montagnes, les Alpes, vues des environs de Milan. Le tableau commencé en 1503, laissé inachevé en 1519, apparaît comme une somme de « la science de la peinture », selon l’expression de Vinci, c’est-à-dire une somme des investigations scientifiques mises en œuvre dans le tableau mais aussi une somme de ses avancées personnelles concernant son art.
ll s’appuie sur ses recherches en hydrologie, en géologie, sur la lumière pour rendre compte en particulier de la force créatrice des quatre éléments. L’eau travaille la terre : à l’arrière-plan elle a sculpté le bas des montagnes ; au premier plan, elle a stratifié le rocher pour en faire des galets. La lumière, air et feu, permet ces transitions imperceptibles entre les clairs et les sombres que constitue le sfumato, qui donne aux horizons et aux chairs cette lumière douce si particulière.
Les quatre règnes de la nature sont représentés : aux plis des montagnes répond le drapé des étoffes, plis arrondis, plis circulaires. Les pattes de l’agneau entrent dans le même mouvement que les membres de l’enfant. Feuillage et toison animale rivalisent de précision. Mais c’est l’humain qui retient le peintre : l’anatomie, la parure, ses jeux de matériaux et de couleurs, ses enroulements, ses transparences, la coiffure, l’enchaînement des gestes, les expressions.
Somme aussi de ses avancées personnelles concernant son art : ses techniques, la façon par exemple de juxtaposer la couleur de la peau et le bleu froid des montagnes parce que « chaque couleur paraît plus noble sur les confins de son contraire… » (Traité de la peinture n° 642), et ses différentes perspectives : « Il y a trois sortes de perspective : la première traite des règles de diminution des choses qui s’éloignent de l’œil, et on l’appelle perspective diminutive ; la seconde comprend la manière d’atténuer les couleurs à mesure qu’elles s’éloignent de l’œil ; la troisième et dernière s’emploie à expliquer comment les choses doivent être moins nettes proportionnellement à leurs distances. Et nous les appellerons : perspective linéaire, perspective des couleurs, perspective d’effacement. » (ibidem n° 204). Il nous introduit aussi au mystère de sa création : son détachement de la tradition et de l’autorité, la liberté que lui donne la nature, qu’elle soit investigation physicienne ou confiance dans l’humain. Dans les dernières salles, de très belles œuvres de Michel-Ange, de Pontormo, de plus récentes comme celle de Max Ernst montrent qu’à son tour il a été un maître.
Le pouvoir de fascination du tableau va donc bien au-delà du sujet religieux. Comme une image de rêve avec ses déplacements, ses dédoublements, ses condensations, il représente de multiples façons la question de la création artistique pour Léonard de Vinci.
L’enquête à laquelle s’est livré le commissaire de l’exposition Vincent Dieulevin pour retrouver ces très nombreux témoignages sur la genèse du tableau incite le spectateur à adopter lui aussi une attitude active tout au long de la visite et à s’interroger sur ce mystère : comment le peintre s’est-il saisi de ce motif conventionnel, presque artificiel, de la Sainte-Anne pour en faire un tableau dont la grâce évidente renvoie à un manifeste plein d’énergie sur le pouvoir de la peinture.
Maryvonne Lemaire








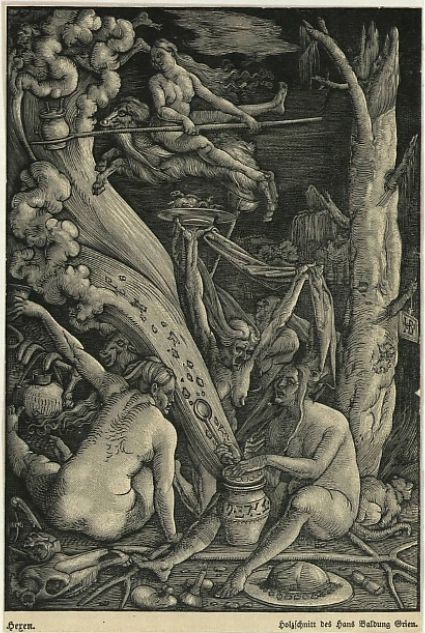













![unnamed[3]](http://www.ouvroir.info/libresfeuillets/wp-content/uploads/2015/05/unnamed3.jpg)